Toute personne sourde a très
longtemps été isolée du reste de la communauté.
Il était donc impossible pour lui
de communiquer avec un langage enrichi, il devait simplement user d’une
gestuelle somme toute très basique.
En conséquence de quoi son esprit
ne pouvait se structurer comme toute autre personne ayant un lien normal avec
le monde environnant et pouvant questionner celui-ci. L’idée a alors été très fortement
insérée dans les esprits, principalement au
Moyen Age
, qu’une personne sourde
est « idiote » (reprise des termes de l’époque), dotée de capacités
intellectuelles en dessous de la normale. Ceci s’inscrit dans la ligne
directe de la pensée véhiculée à l’époque. Ainsi même Platon proclamait que
toute personne n’étant pas en mesure de parler, ne pouvait pas penser. Autrement dit, langage (parlé) et
intelligence auraientt un lien quelconque, ceci contribuant à rejeter complètement
les sourds de notre société. Les sourds n’ont alors d’autres
moyens que de se regrouper et vivre ensemble pour pouvoir espérer élaborer un
semblant de LSF. Toutefois des personnes
entendantes vont petit à petit au fil de l’histoire s’intéresser à ce monde si
différent du leur.
Pourtant si l’on remonte le fil
de l’histoire on s’aperçoit que le monde sourd existe depuis longtemps. Ainsi au
12ème siècle avant JC l’ancien
testament avisait déjà de leur présence.
Platon
écrivait même à leur sujet, évoquant leur mode de communication par des gestes.
Même si leur présence est
reconnue, les sourds sont dans l’
incapacité de parler et de recevoir une
éducation (donc d’apprendre à lire et à écrire). Ils sont ainsi reconnus comme
des personnes
irresponsables, placés sous le contrôle de
tuteurs,
n’ayant
aucun contrôle
sur leurs biens propres. De même ils sont dans
l’incapacité totale de se marier jusqu’au
12ème siècle. Il faudra attendre cette
date pour que le pape autorise enfin leur mariage.
Au
16ème siècle, quelques
sourds issus de famille riches peuvent espérer recevoir un début d’éducation.
(Ex. en Espagne Pedro
Ponce qui
fait parler des sourds nobles).
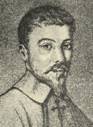
En
1620 Pablo
Bonet rédige le
premier livre dédié à l’éducation des
sourds.
Celui-ci contiendra entre autre un alphabet
manuel.
Un peu partout en Europe on mène des
recherches sur l’éducation des jeunes gens sourds, mais
la France est en
retard.
Fort heureusement le
18ème
siècle va constituer un
tournant majeur.
En
1779, Pierre
Desloges rédige le premier livre écrit
par un sourd
« Observation d’un
sourd-muet ».
En
1760 l’
abbé de l’Epée fut l’un des premiers
à s’intéresser durablement au monde sourd et à son éducation.
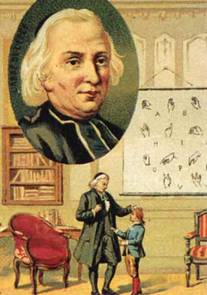
Il étudie plus particulièrement
deux jumelles sourdes correspondant l’une avec l’autre, il existe donc bien une
certaine forme, primaire certes, de langage des sourds. C’est grâce à lui que
vont se
regrouper pour la première fois les enfants sourds. A leur contact, il
parvient à comprendre leur langage. Il leur enseignera donc via une méthode
toute particulière de son invention :
les signes méthodiques,
mettant en valeur les ressources de la vision. Le français écrit sera ainsi
largement préféré en comparaison à l’articulation.
Rien encore à voir donc avec
la LSF actuelle.
Mais le plus important demeure : l’abbé a compris quelle était
l’importance de la communication gestuelle dans l’enseignement dispensé aux
enfants sourds.
Loin de faire de sa méthode un
secret bien gardé,
il forme aussi d’autres professeurs français mais
aussi plus largement européens, pour les sourds.
Il poussera son action jusqu’à
aller
plaider leur cause à la cour du roi et pourra par la suite
créer
l’école des sourds muets de Paris, devenant par la suite
l’Institut Saint Jacques de Paris en
1797. (Cf. projet de Condorcet relatif à l’organisation
générale de l’instruction publique).
Les principes chers à l’Abbé y
seront effectivement appliqués.
En parallèle des figures
mythiques du monde sourd vont se développer comme celle de
Ferdinand Berthier, figure de l’intellectuel sourd,
mais aussi fervent défendeur des droits des sourds et de la reconnaissance de
leur langue.

 HISTORIQUE DE LA CULTURE SOURDE
HISTORIQUE DE LA CULTURE SOURDE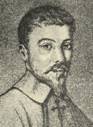 En 1620 Pablo Bonet rédige le premier livre dédié à l’éducation des
sourds.
En 1620 Pablo Bonet rédige le premier livre dédié à l’éducation des
sourds.
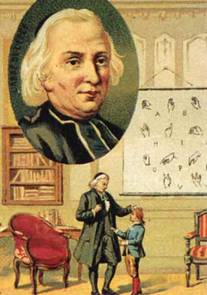
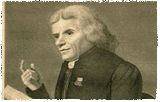 nouveaux signes
méthodiques…mais son langage est vite contesté voir abandonné. En effet, les
sourds se retrouvent obligés de faire appel à la langue des signes naturelle
pour expliquer la signification des nouveaux signes méthodiques. Même si son dévouement est clair,
il ne comprend pas la réalité du monde sourd, tant psychologique que sociale. Berthier écrira ainsi à son
propos : « Nous regrettons
seulement qu'au lieu de reconnaître ses erreurs, il n'ait pas cru devoir avouer
franchement son ignorance complète de la langue naturelle du sourd-muet. »
nouveaux signes
méthodiques…mais son langage est vite contesté voir abandonné. En effet, les
sourds se retrouvent obligés de faire appel à la langue des signes naturelle
pour expliquer la signification des nouveaux signes méthodiques. Même si son dévouement est clair,
il ne comprend pas la réalité du monde sourd, tant psychologique que sociale. Berthier écrira ainsi à son
propos : « Nous regrettons
seulement qu'au lieu de reconnaître ses erreurs, il n'ait pas cru devoir avouer
franchement son ignorance complète de la langue naturelle du sourd-muet. » De nombreuses
manifestations vont voir le jour visant à promouvoir
De nombreuses
manifestations vont voir le jour visant à promouvoir