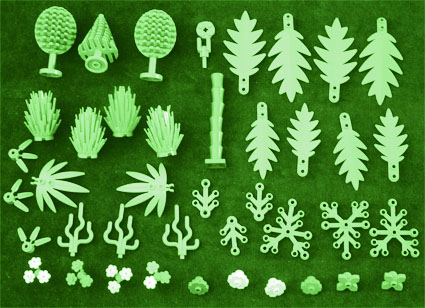Échelles
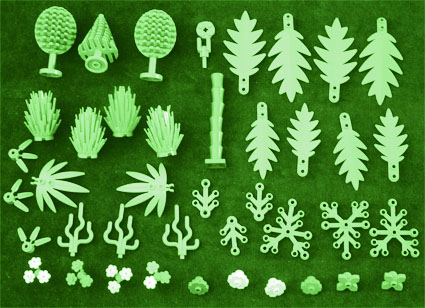
Quel niveau ?
Une des questions clés, sur laquelle les négociations n’ont permis de trouver aucun consensus, est celle de l’échelle géographique, avec 3 possibilité : subnational (ou par projets), national, ou un mélange des 2 échelles appelé « nested approach ». Ces échelles réfèrent au niveau de comptabilité du mécanisme REDD, étroitement lié au niveau de credititing, c'est-à-dire de paiement.
Subnational
A l’échelle subnationale, les activités pour la réduction des émissions seraient implantées dans une aire définie, sous forme de projets menés par des communautés, des ONG, le gouvernement local… Quelque que soit l’approche, des règles internationales sont nécessaires pour le monitoring et la vérification, le système de crédits et une coordination entre le niveau national, c'est-à-dire l’autorité nationale qui approuve les projets, et le niveau international, organe qui supervise ses projets et la distribution de crédits.
Un des exemples d’une telle approche est celui du Mécanisme de développement Propre (MDP) dans le cadre du protocole de Kyoto, permet aux pays de l’annexe I de soutenir des projets dans les PED de réduction d’émissions. En ce qui concerne les projets dans le secteur forestier, très peu de projet ont été approuvés, même si mécanisme a mieux fonctionné dans d’autres secteurs comme l’énergie. Cela s’explique notamment par les règles et méthodologies complexes exigées, ce qui rend difficile l’établissement de projets par les PED.
Dans le cadre de l’UNFCC, un projet récent a été soumis par le Paraguay au nom de l’Argentine, Panama, et du Perou. Cette échelle est soutenue par les ONG américaines comme TNC et CI.
National
La plupart des pays sont cependant en faveur d’une approche nationale. Combattre la déforestation entraîne des changements dans la politique d’un pays, et cette échelle permet d’agir à une échelle plus large et de manière plus permanente. Les pays seraient ici récompensés pour des réductions d’émissions mesurées par rapport à un niveau de référence établi.
Chaque pays participants aurait la responsabilité de mettre en place des mesures selon son contexte pour réduire les émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts.
Nested
Dans la « nested approach », les pays peuvent lancer REDD à différents niveaux, et commencer à l’échelon subnational pour passer ensuite au national quand leur capacité d’action aura été renforcée. La transition au national serait obligatoire, mais il existerait la possibilité de créditer des projets individuels. A la fin de chaque période, le pays devra déduire les crédits issus de réductions menées au niveau local des crédits nationaux. Si la réduction est un échec à l’échelon national, les projets subnationaux validés sont quand même crédités. Cette approche est séduisante, mais l’harmonisation des deux niveaux est un véritable challenge.
Un des critères de choix est celui de l’effectivité. Pour approches nationales, il est nécessaire d’établir des références nationales (scénarios) crédibles, et les négociations internationales ont beaucoup de difficultés à résoudre tous les problèmes associés à l’élaboration d’un scénario de référence ! L’échelle nationale permet de réformer les politiques pour mener des actions à plus grande échelle, ce qui est plus efficace en terme de surface couverte, même si le risque de bureaucratie existe.
Cependant, les investisseurs privés peuvent être réticents à acheter des réductions d’émissions aux pays car ils n’ont pas de contrôle au niveau national, et préfèrent investir dans des projets tangibles. Ceux-ci pourraient par ailleurs avoir d’autres bénéfices comme la réduction de la pauvreté et la protection de la biodiversité.
Si l’échelon local permettrait de davantage impliquer les indigènes, l’argent risque de passer entre les mains de ceux qui contrôlent directement les forêts.
A cela s’ajoute un problème de fuites : à la fois à l’échelle nationale, que la déforestation se déplace d’une zone à l’autre en fonction des projets menés, mais aussi internationale, entre les pays. Un mécanisme inclusif à l’échelle internationale, permettant à tous les pays d’y participer selon leur degré de développement, est nécessaire. Si les échelles subnationales et « nested » parviennent mieux à prendre en compte les contextes spécifiques des différents pays (leur stabilité politique, leur capacité d’action…), c’est aujourd’hui l’approche nationale qui est plébiscitée par la majorité des pays et des ONG en raison de sa plus grande rigueur.