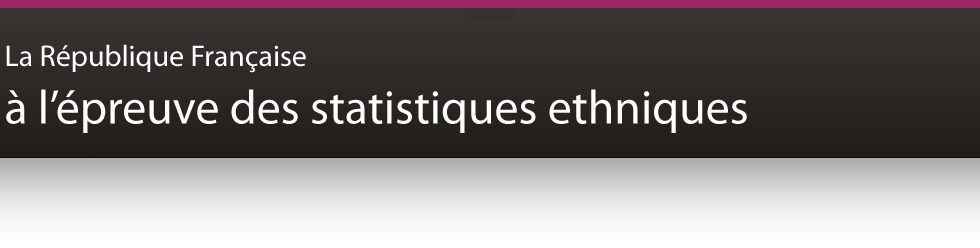Immigration, intégration, cohésion sociale, identité nationale… Ces préoccupations cristallisent aujourd’hui le débat en France dans la sphère médiatique et politique. L’intervention de nombreux acteurs hétérogènes témoigne de la difficulté d'appréhender la thématique de la « diversité » telle qu’elle se pose aujourd'hui.
Dans son article 1er, la Constitution française énonce le principe républicain d’indifférence aux origines qui garantit l’égalité des chances et des individus. Toutefois, cette prétention universaliste de la conception de la citoyenneté semble désormais être mise en échec face à la montée des inégalités et des discriminations.
Le défi de représenter la société française dans sa " diversité " a conduit certains chercheurs, hommes politiques et associations à proposer l’usage de statistiques ethniques pour identifier et quantifier ces discriminations qui affectent la République au mépris de son idéal d’égalité.
C’est dans ce climat passionnel qu’émerge la polémique sur la compatibilité des statistiques ethniques avec le modèle républicain français. La construction d’une vision ethnicisante de la société ne remet-elle pas en cause l’égalité entre les citoyens français ? L’usage des statistiques ethniques permet-il de faire progresser les connaissances sans faire reculer les libertés ? Quels en sont les bénéfices et les dangers ?
Les enjeux sociopolitiques soulevés par cette controverse suscitent la mobilisation d’acteurs toujours plus nombreux, sans pour autant faire l’objet de connaissances scientifiques ou techniques assurées. Tandis que certains y voient un espoir d’améliorer la compréhension de la société pour mieux agir, d’autres y entrevoient des menaces : un retour de la notion de race, une " légitimisation " des comportements discriminatoires et des dérives idéologiques. C’est cette controverse que notre étude s’attache à représenter.
Mieux comprendre le fonctionnement de notre société
La nouvelle réalité de la diversité française a suscité des questionnements inédits. Dès 1991, certains démographes tels que Michèle Tribalat ont cherché à appréhender les populations en fonction de leurs origines pour mieux répondre aux défis d’intégration provoqué par l’immigration. Les chercheurs proposent alors un découpage en catégories ethno-géographiques pour « révéler » les modes d’organisation spontanées de la société.
Au début des années 2000, des liens directs sont établis entre l’échec d’intégration de personnes issues de l’immigration et la délinquance. À cet égard, les émeutes de novembre 2005 ont alerté les consciences sur le quotidien discriminatoire de certaines parties de la population. Ces violences urbaines ont démontré la nécessité et l’urgence de décisions politiques. C’est dans ce contexte que la controverse va investir le terrain politique et devenir un enjeu de gouvernance.
En 2007, Brice Hortefeux, alors ministre de l’immigration, de l’identité nationale et du co-développement, dépose un amendement sur les statistiques ethniques dans un projet de loi durcissant le contrôle de l’immigration. Jusqu’à alors méconnue du grand public, la question des statistiques ethniques prend une grande portée symbolique en attaquant le principe républicain d’indifférence aux origines. Censuré par le Conseil Constitutionnel, cet amendement sur les " études sur la mesure de la diversité des origines " révèle pour la première fois un court-circuit explicite entre les scientifiques d’un côté, les acteurs politiques de l’autre, et l’opinion publique épouvantée par la remise en cause du modèle de société français.
En septembre 2008, la controverse connaît un nouveau sursaut dans le milieu scientifique et politique lors de la mise en place de l'étude Trajectoires et Origines (TeO) : une enquête statistique sur la mesure des phénomènes d’intégration et de discrimination. Depuis, l’usage des statistiques ethniques n’a cessé de prendre une importance considérable dans la recherche de solutions efficaces pour gouverner. Nicolas Sarkozy a d’ailleurs énoncé explicitement dans son discours de Palaiseau en décembre 2008 ses priorités gouvernementales : " L'égalité des chances doit cesser d'être théorique pour devenir réelle ". En conséquence, Le Président de la République nomme Yazid Sabeg au poste de Commissaire à la Diversité et à l’Égalité des chances afin " d’identifier, d’évaluer et de proposer les catégories d’observation mobilisables, (...), pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations ". Yazid Sabeg charge alors le chercheur à l’Institut National d’Études Démographiques (INED) François Héran de constituer un groupe de travail indépendant réunissant des représentants de tous les secteurs pour travailler sur " un usage critique et responsable de l’outil statistique " : le Comité de la Mesure et l’Évaluation de la Diversité et des Discriminations (COMEDD).
Un outil controversé
Mieux comprendre la diversité de la population française et lutter contre les discriminations s'inscrit dans l’idéal d’égalité républicain. À cet égard, les " statistiques ethniques " pourraient constituer un outil décisif dans l’élaboration d’une connaissance critique de la société française. Toutefois, cet outil fait peur et polarise les oppositions. Le colonialisme, la seconde guerre mondiale, les fichiers de Vichy sont autant de drames historiques qui ont laissé une empreinte forte dans la société française. Court-on aujourd’hui le risque avec les " statistiques ethniques " de reproduire les erreurs du passé ? S’agit -il de ficher, de compter, ou encore de catégoriser les individus en portant atteinte à la prétention universaliste de la citoyenneté française? Yazid Sabedg affirme qu’il n’en est rien : la mission ne consiste nullement à " établir des fichiers ".
Il apparaît que les possibilités permises par les statistiques ethniques sont immenses mais également risquées. La production de catégories ethniques ont-elles pour seul but de comprendre la société ? Leur utilisation en fonction de visions politiques ont-elles à l’inverse un pouvoir de performation du social ? C’est précisément ces éléments controversés que notre étude s’attache à représenter à partir du 17 décembre 2008, date du discours sur l’égalité des chances, prononcé par Nicolas Sarkozy. Étape charnière dans le développement de la controverse, le discours de Palaiseau introduit la controverse de façon simultanée dans la sphère publique et scientifique. Notre étude s'achève au printemps 2010, lors de la remise du rapport du COMEDD, lorsque cette transformation systémique prend fin.