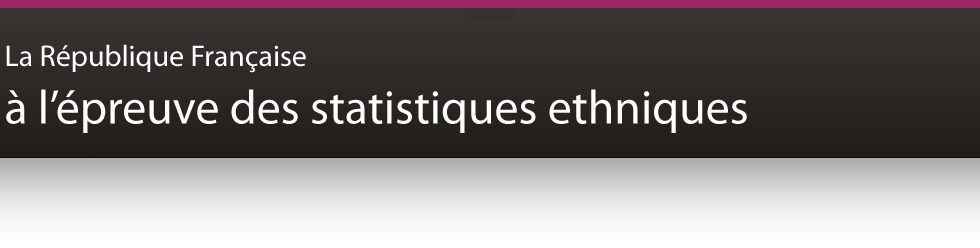La statistique sociale et les activités d’enquêtes font l’objet en France d’un encadrement juridique strict. Le traitement de données statistiques sur les origines ethniques ou sociales est particulièrement contrôlé.
Toutefois, contrairement à une conviction répandue, il n’existe pas en France d’interdiction absolue du traitement statistique des données ethno-raciales, dès lors qu’elles ne figurent pas dans les fichiers nominatifs de gestion ayant une incidence sur le sort des personnes et qu’elles ont pour finalité de saisir l’ampleur et le mécanisme des discriminations.
Les études statistiques peuvent-elles légalement traiter des données sensibles " relatives aux origines des personnes " ?
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite " Loi Informatique et libertés " encadre la protection des données personnelles. Elle a créé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). À la question de savoir si on peut traiter statistiquement des données " relatives aux origines des personnes " , la loi Informatique et libertés livre une réponse nuancée, de la forme " non, sauf si ".
Le traitement dérogatoire des données ethno-raciales
En effet, l’article 8-1 de la loi Informatique et libertés énonce avec force une interdiction de principe contre le traitement de données sensibles et prévoit des sanctions dans le Code Pénal (article 226-19). Cependant, une dizaine de dérogations sont prévues aux articles 8-II, 8-III, et 8-IV.
La directive communautaire de 1995 et le débat autour de la " loi Hortefeux "
En 1995, la transposition de la directive communautaire 95/46/C « relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » dans la loi du 6 août 2004 élargit l’éventail des possibilités accordé aux statisticiens dans l’utilisation des dérogations énumérées par la loi Informatique et libertés.
L’opposition déféra la nouvelle loi devant le Conseil Constitutionnel. La saisine échoua. Par décision du 29 juillet 2004 (n°2004-499 DC), le Conseil Constitutionnel décida de valider en l’état la transposition de la directive de 1995 dans la loi de 2004.
Dans une décision du 15 novembre 2007, le Conseil Constitutionnel a du statuer sur l’introduction d’une nouvelle dérogation sur les « études sur la mesure de la diversité des origines » devant modifier la loi Informatique et libertés dans le cadre du débat sur la « loi Hortefeux » relative au contrôle des flux migratoires.
Le juge constitutionnel censura cet amendement et souligna qu’un traitement de données reposant sur les origines raciales ou ethniques contrevenait au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens « devant la loi » affirmé dans l’article 1er de la Constitution.