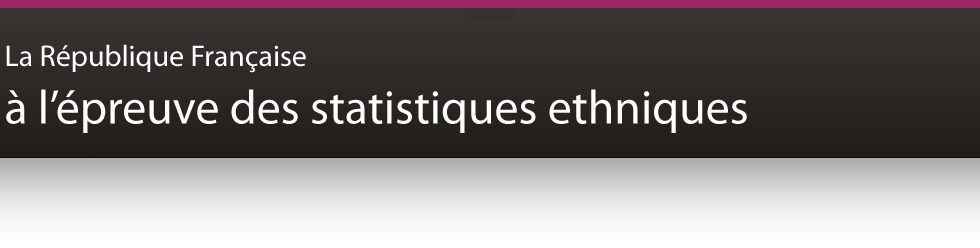La politique suit-elle toujours la science ?
L’étude de la controverse sur les statistiques ethniques en France a révélé une tension vive autour du modèle républicain et de son adéquation avec les enjeux d’une société technicisée. Comme Bruno Latour l’a rappelé dans une tribune publiée par Le Monde en mai 2010, nous chérissons toujours " [l]’idéal d’une République fondée en raison. Selon cet idéal, l’action politique suit les lois de la science (…). "
Issue du compromis moderniste, cette logique qui sépare la science et l’action politique semble toutefois largement discutable. Dans son ouvrage Nous n'avons jamais été modernes, le directeur adjoint de Sciences Po chargé de la politique scientifique, souligne que la science et la politique sont " coexistentives ".
C’est précisément ce que révèlent les conclusions de notre étude. En ce sens, la controverse sur les statistiques ethniques en France constitue une illustration très explicite de l’argument de la co-production de la science et de la politique. Les catégories présentent des effets immédiats sur l'ordre social et influent sur la manière de gouverner.
La question des outils de la mesure de la diversité a d’ailleurs été interprétée par les responsables politiques comme un enjeu technique. Ainsi Yazid Sabeg, Commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, a souhaité réunir un comité de scientifiques pour évaluer la pertinence de ces instruments. Or la production de catégories ne relevant pas uniquement de la seule activité scientifique, François Héran, chargé de la direction de ce comité, a veillé à représenter les principales parties prenantes de la société, rendant ainsi compte du caractère socio-technique de la controverse.
La mission difficile des experts
François Héran, président du COMEDD, fait partie des experts qui, selon Latour "…accepte une mission impossible " , car " il doit résumer pour le bénéfice des politiques un immense front de recherche étonnamment varié en quelques certitudes grossières ". Cependant, le rapport du COMEDD chargé " d’identifier, d’évaluer et de proposer les catégories d’observation mobilisables " n’a pas apporté les conclusions définitives et irrévocables attendues par le gouvernement.
Par ailleurs, rappelons que ce rapport à été rendu au gouvernement avec un retard de six mois car, selon son Président, il a fallu du temps pour trouver un consensus. La mission du COMEDD livre donc un exemple de la mutation du métier des chercheurs, encouragés eux aussi à co-produire avec des acteurs non issus de la seule sphère scientifique.
Cette initiative proposée pour organiser la controverse a finalement conduit à la propager davantage. Sa contribution est également qualitative puisque qu’en invitant les acteurs à se positionner plus clairement qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à présent, le COMEDD a apporté une plus grande lisibilité au débat dans la société française.
La dynamique de la controverse caractérisée par sa non-linéarité
Le caractère polyphonique propre à toute controverse s’est doublé, dans le cas des statistiques ethniques, d’une difficulté générale entre les acteurs à s’accorder sur une définition des notions mises en jeu et sur les faits qu'elle recouvrent exactement. À titre d’exemple, la question sur le lieu de naissance a été préconisée par le COMEDD comme faisant partie des questions sur l'État civil, tandis que pour Louis Schweitzer, ancien président de la HALDE, cette question mène nécessairement à la question ethno-raciale. La grande diversité d'acteurs et la pléthore des thèmes évoqués n’ont donc pas permis d’obtenir une vision linéaire de ce débat.
Cette non-linéarité a eu une incidence directe sur la représentation de la controverse. À cet égard, il est apparu impossible de localiser dans le temps et l’espace de la controverse, les points chauds que nous avions identifiés à travers la lecture du discours des acteurs (le sens de la notion de l’ethnie, l’effet performatif des statistiques et la gestion des donnés).
Enfin la cacophonie générale des acteurs impliqués dans la controverse s’est confrontée aux passions de l’opinion publique. Le traitement statistique des données ethno-raciales serait, conformément à une idée répandue dans la société civile, absolument interdit en France. Dans ce climat conflictuel, autoriser l’usage des statistiques ethniques à la faveur d’une loi durcissant le contrôle de l’immigration (Loi Hortefeux) semblait ouvrir une brèche dans le grand principe républicain d’indifférence aux origines, et de briser un " tabou fondateur " cher aux citoyens français.
Or contrairement à cette idée répandue dans le débat public, il n’existe pas en France d’interdiction absolue dans ce domaine, notamment pour les enquêtes menées par des instituts privés. Aujourd’hui, les représentations de ce débat public autour des statistiques ethniques ne sont pas fidèles au travail des experts portant principalement sur la gestion des données obtenues par de telles statistiques.
La République française à l’épreuve des statistiques ethniques
Pluridimensionnelle, la controverse sur les statistiques ethniques se caractérise par une situation initiale d’interlocution polémique entre les experts statisticiens. Les affrontements qui ont divisé une partie des démographes depuis dix ans ont finalement produit un déplacement des positions et de la controverse elle-même. Les acteurs politiques se sont emparés de la connaissance produite par les chercheurs dans une visée démocratique, exprimant la nécessité pour la France de " se doter d’outils statistiques permettant de mesurer sa diversité (...) d’identifier précisément ses retards et (de) mesurer ses progrès ".
L’impulsion donnée par le Président de la République dans son Discours de Palaiseau et par la mission de Yazid Sabeg s’apparente dès lors à un enjeu technique de gouvernance faisant apparaître un court-circuit entre le domaine de la science et de la politique.
Si la nécessité d’agir contre les dysfonctionnements de la société est reconnue par l’ensemble des acteurs, toutefois la polémique prend forme dans l’opinion publique sur la stratégie et les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre les discriminations. Les questions sémantiques et les confusions polarisent les oppositions sur les valeurs et les idéaux de la République française.
La tentative de stabilisation de la controverse par le travail du COMEDD constitue une étape charnière. Pourtant loin de clore la controverse, la publication de ce rapport n’apporte pas de réponse définitive sur la compatibilité entre l’usage des statistiques ethniques et le modèle républicain français. Mais une chose est sure : l’introduction des statistiques ethniques en France serait une expérimentation s’appuyant sur certaines thèses concernant les effets sur la société.
Cela laisse à penser que seules les connaissances accumulées seront en mesure de répondre à cette exigence sans exacerber le climat conflictuel et passionnel. Cela correspond au projet d'une philosophie pragmatique, qui de Dewey à Latour, se demande comme l'a fait récemment ce dernier, s'il est " si absurde de s'appuyer non plus sur la science mais sur la recherche et sur l'expérimentation ".