
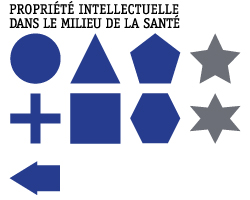

Pfizer
ABL : Advanced biological laboratories
Sanofi-Aventis
Institut Curie
Fondation Gates
Fédération Internationale de l'Industrie du Médicament
Act UP
Knowledge ecology international
ReMeD (Réseau Médicament et Développement)
ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau)
Médecins du monde
Oxfam International
Médecins Sans Frontières
Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme
UNITAID
OMPI
OMS
OMC
PNUD et ONUSIDA de l'ONU
Le Gouvernement des Etats-Unis
La Commission Européenne
Le gouvernement canadien
Le gouvernement indien
Le gouvernement thaïlandais
Le gouvernement d'Afrique du Sud
Les gouvernements des Pays les Moins avancés
Le gouvernement brésilien
Michael Kremer
Marcelo Dias Varella
Patrice Trouiller
Barbara Pick
Barton et Emmanuel
Emeric Henry
Hanna Ketler
David B. Ridley, Henry G. Grabowski et Jeffrey L. Moe
Paul Belleflamme et Tanguy Van Ypserle
Poids dans la controverse
Pfizer est le premier laboratoire médical privé dans le monde. D'origine américaine et basé à New York, il commercialise actuellement plus de 30 médicaments, pour un chiffre d'affaire équivalents à 82 milliard de dollars et l'obtention de 350 brevets cette année (tous ne seront pas utilisés). Il se présente comme un ferme défenseur du brevet, demandant on affermissement avec un durcissement de la loi, et un rallongement des délais. Le discours officiel de ce laboratoire est très américano-centré, et c'est avant tout pour défendre les "droits des américains" que Pfizer défend l'innovation efficace.
La place des pays émergents est très effacée. Ils sont plus considérés comme des marchés potentiels, et la question de la récompense n'est pas évoquée. On peut donc considérer que Pfizer a une position tranchée en ce domaine : oui aux brevets, et seulement aux brevets.
Arguments
- Un des laboratoires qui investit le plus dans la recherche (8,1 milliards en 2007)
- Les recherches sont très longues et coûteuses, et il est rare que les recherches débouchent sur un médicament viable. Il faut donc avoir un but suffisant pour continuer la recherche. Les conditions de recherches sont de plus en plus strictes, et les règles à respecter de plus en plus dure, donc onéreuses.
- Les ressources dégagées par leur commercialisation est l'unique moyen de financer d'autres recherches.
- Les brevets protègent des idées, qui représentent la véritable richesse de l'innovation du laboratoire. Les employés se voient récompensés de leurs efforts grâce à de hauts salaires issus de ces brevets.(bienfaits sociaux ?)
- Tous les médicaments que propose l'OMS viennent de laboratoires privés qui basent leurs recherches sur l'industrie des brevets.
L'absence des brevets comprend des dangers :
- La prolifération de contrefaçons, en particulier sur Internet. Les premières victimes sont donc les patients.
- Une absence de respect des personnes qui ont travaillé leur vie durant sur les projets.
- Les pays en développements ne vont pas promouvoir l'innovation lorsque leur économie le permettra et ce sera une grande perte en matière de santé publique.
Néanmoins, devant l'augmentation des brevets arrivant à échéance, Pfizer compte se lancer dans une campagne de fabrication massive de génériques pour les pays en développement. Officiellement pour pallier à la mauvaise qualité des médicaments existants, en réalité pour conquérir ces nouveaux marchés, car selon le directeur de la filiale française, le marché est loin d'être saturé.
Poids dans la controverse
Ce laboratoire est un pionnier européen, crée en 2000 par le centre de recherche européen, et concentre ses recherches sur la tri-thérapie dans la lutte contre le VIH. Localisé à Luxembourg, il est présent dans une partie des pays d'Europe occidentale (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas) et au canada.
Il possède également de nombreux partenariats avec les laboratoires comme Evivar ou Viralliance, avec lesquels il édite des brevets, créant ainsi une grande distribution de ses produits (et un grand monopole). Il a également des accords avec des laboratoires situés dans des pays en développement, comme TCELS en Thaïlande qui promeut ces tri-thérapies.
Position dans la controverse :
Son leitmotiv officiel et d'aide la prise en charge des personnes, et d'améliorer leur contradictions de santé. Mais il ne précise pas à quel prix et se considère plutôt comme un pôle d'excellence qu'un distributeur de "public goods". Il estime que la seule façon de protéger ses découvertes, qui sont le résultat de nombreuses années de recherche est de les protéger par des brevets. De plus, pour eux, le brevet est le seul moyen viable de promouvoir l'innovation contrairement aux autres alternatives qui sont à peine évoquées, car considérées comme inefficace, et étant la ruine des groupes laboratoires.
S'il reconnaît qu'aider les pays en voie de développement est important, dans la pratique. il s'en sert plutôt comme de nouveaux débouchés grâce à l'obtention de partenariats plus ciblés, plutôt que de développer des programmes spéciaux d'aide par la fabrication de génériques.
On perçoit donc que malgré son incorporation à une dynamique européenne, ce pôle de recherche est plutôt en décalage avec le discours officiel, étant alors plus proche de la position américaine des grands laboratoires américains.
Poids dans la controverse
Sanofi-Aventis est le leader de l'industrie pharmaceutique française. En terme de déposition de brevets d'une part, avec 153 brevets déposés en 2010, et en terme de revenu d'autre part avec un chiffre d'affaire de 30 384 millions d'euros pour la même année. Bien que localisé à Paris, le groupe a des filiales dans plus de 100 pays, ce qui lui donne une influence mondiale. Il est d'ailleurs leader mondial des vaccins humains, sa principale source de revenu.
Position dans la controverse
Sa position est probablement la plus représentative des grands laboratoires des pays développés. Sanofi-aventis considère que la défense des brevets est de la responsabilité de toutes les parties prenantes, et de façon directe et active, des gouvernements qui doivent être les garants d'un cadre légal (propriété intellectuelle) et économique (politique de prix, remboursement, fiscalité, etc.) propice à l'innovation.
Toutefois, ils reconnaissent plus ou moins officiellement l'intérêt des récompenses dans le cadre uniquement des maladies rares ou qui concernent les pays en voie de développement. Officieusement, puisque cette information nous a été donnée par un des employés, ils s'inquiètent de cette pratique. Le problème n'est pas tant la récompense en elle même, puisqu'actuellement elle n'est appliquée qu'a des marchés non solvables, mais plutôt le fait que ces marchés puissent devenir rentables et que d'ici là, les pays se soient habitués a de tels systèmes de propriété intellectuelle. Ils refusent que des alternatives comme la récompense ne se diffuse trop, de peur que le brevet ne soit plus une référence universelle.
Arguments
La mise au point d'un médicament est un processus complexe, long, risqué et coûteux. Sa durée est estimée à 15 ans en moyenne et sur 10 000 molécules potentiellement intéressantes, une seule deviendra un médicament.
Les brevets, quant à eux, ont une durée théorique de 20 ans. En pratique, ils ne couvrent qu'une période relativement courte (8 à 10 ans) de la vie commerciale du médicament car ils prennent effet dès qu'ils sont délivrés (avant les essais cliniques). (il faut noter que les brevets pharmaceutiques bénéficient déjà d'une législation particulière qui leur permet de durer en moyenne 2 à 4 ans de plus que les brevets ordinaires.)
En conséquence, sanofi-aventis considère que la défense des brevets est un enjeu majeur assurant la viabilité de l'entreprise.
Enfin, en obligeant les entreprises concurrentes à développer des molécules différentes, les brevets permettent à l'industrie pharmaceutique de répondre de plus en plus précisément aux besoins spécifiques de chaque patient.
Pour la récompense, le marché et l'incitation sont insuffisants pour rendre la recherche de tels produits rentable.
Poids dans la controverse
L’institut curie est un hôpital, auquel est greffé un centre de recherche. C’est le premier centre de cancérologie en France. Il est mi-privé, mi-public, ce qui lui confère une position particulière. Lorsque les chercheurs et les médecins font une découverte, il confie le relai à un partenaire industriel capable de financer et de conduire le développement du produit, ce qui nécessite le dépôt de brevets. Ils ne brevètent donc pas dans un souci financier, mais simplement pour que leur découvertes soient développées et qu’elles bénéficient in fine à leurs patients. Il est donc difficile de savoir combien de brevets ils émettent par an. En revanche ils sont particulièrement fiers des brevets qu’ils ont réussi à révoquer.
Position dans la controverse
En effet, en raison de leur situation particulière, l’institut Curie se fait le grand défenseur des praticiens qui se retrouve limités par des brevets. En tant qu’innovateurs ils ne sont évidemment par contre le système des brevets, ils sont toutefois pour une meilleure régulation et une refonte du système. Ils s’engagent eux même dans cette lutte via des campagnes de communication et des procès.
Le brevet peut être nuisible à l’amélioration. C’est du moins ce que soutiennent un groupe d’organismes mené par l’Institue Curie concernant le brevet déposé par Myriad Genetics. Ce brevet concernait une méthode de dépistage du cancer du sein pour laquelle le gène BCR1 servait d’étalon. Aussi, le dit gène était-il compris dans le brevet, il « appartenait » alors à Myriad Genetics dans le sens où toute nouvelle découverte qui concernerait le gène, si différente qu’elle soit de celle de Myriad, ne pourrait plus être protégée par un brevet. Personne donc ne veut plus entreprendre des recherches dans le domaine du cancer du sein pour lequel ce gène est central, au risque de voir leurs découvertes confisquées. De manière évidente c’est un frein à l’amélioration, à la recherche et à la pratique médicale. Contrairement aux Etats-Unis, ce dernier point revête une importance particulière en Europe et en France. (On voit bien là combien la culture joue un rôle important dans la propriété intellectuelle même entre les pays du Nord. La controverse n’est pas qu’un problème Nord-Sud. )
Critique du système d’acceptation et de révocation des brevets :
L’institut Curie, ainsi que d’autres organismes de recherche, ont donc engagé un procès accusant Myriads Genetics d’une utilisation abusive de son brevet. Toutefois de tels arguments ne sont pas recevables devant l’office européen des brevets (ŒB), on ne peut contester un brevet sur son fond c'est-à-dire son contenu ou son utilisation mais seulement sur des vices de forme. Pour révoquer ce brevet, il s’agissait donc pour les plaideurs de montrer par exemple que le gène BCR1 avait été mal codé lors du dépôt de brevet. Tout un service de l’institut Curie a donc passé 6 mois a recodé l’ensemble du gène et trouver des erreurs. Ils ont été chanceux : Myriad Genetics dans sa précipitation avait fait deux erreurs, le brevet a été révoqué par l’ŒB, et il n’est plus appliqué en Europe. Cet exemple illustre les distorsions que les brevets peuvent créer dans le domaine de la recherche. D’une part, la ‘course aux brevets’ précipite des découvertes dont la qualité est moindre. D’autre part, le système actuel de révocation des brevets est critiqué, les arguments de fond devraient être recevables, et l’ŒB devrait disposer de services de recherche. Forcer les instituts de recherche comme Curie a perdre du temps sur des détails pareil pour avoir le droit d’entamer de la recherche sur le cancer du sein est aussi un frein à l’amélioration.
De cet exemple on peut tirer une conclusion sur le rôle des laboratoires et des instituts de recherche : Par ce procès, les laboratoires ont régulé le système de propriété intellectuelle, en sanctionnant une utilisation abusive d’un brevet. L’opposition, puis la révocation de ces brevets auront sans doute un effet dissuasif pour d’autres détenteurs de brevets. En utilisant la procédure d’opposition aux brevets sur les gènes du cancer du sein, les institutions scientifiques et médicales européennes ont exercé un rôle régulateur sur la propriété des inventions biomédicales, sans qu’il soit besoin pour le Ministère de la Santé d’en arriver à l’attribution d’une licence obligatoire. Elles ont conforté leur intervention dans le domaine de la propriété intellectuelle, non seulement comme déposantes de brevets dans le cadre de leurs missions de transfert de technologie, mais aussi comme opposantes dans une situation où le maintien de ces brevets s’avérait contraire à l’intérêt de la santé publique. L’institut Curie s’en félicite, bien que ces médecins et chercheurs jugent que ce n’est pas leur rôle.
Rôle/activité
Fondation de mécenat privé réunnissant de nombreuses grandes fortunes, dont les principales activités sont l'aide et le financement à la recherches pour des remèdes contre toute sortes de maladies, et à la subvention de programmes d'allocation de ces remèdes pour les plus démunis.
Position
En faveur du mécénat public et privée, elle soutient toute forme de système favorisant l'aide et le secours aux plus démunis. Au dela du simple rôle de mécénat classique la fondation Gates abrite aussi des chercheurs qui proposent des réformes du système de la propriété intellectuelle comme Hannah Kettler.
Rôle/activité
La FIIM est une ONG internationale à but non lucratif représentant les secteurs de la recherche pharmaceutique, biotechnologique et vaccinale. Elle regroupe 26 des principales sociétés internationales de renom.
Position
En faveur d'un respect ou d'un renforcement des droits de propriété intellectuelle. Hostile à l'utilisation de licences obligatoires, et en faveur d'un système de responsabilité sociale des entreprises pour remédier aux problèmes actuels de santé mondiale.
Rôle/activité
Association de lutte contre le Sida.
Position
Propose la mise en place de taxe sur les profits de l'industrie pharmaceutique, l'interdiction du démarchage des médecins par des représentants de ces industries. Estime que le système actuel des brevets nuit à l'innovation dans de nombreux secteurs et la perverti, exploite les population par les prix.
Rôle/activité
Site spécialisé dans la propriété intellectuelle notamment dans le domaine de la santé.
Position
Très axée sur les innovation en propriété intellectuelle: licence obligatoire, récompense etc...
Position
Se satisfait du sens pris par les Accords sur l'ADPIC à Doha, avec l'utilisation de licences obligatoires, et se positionne en faveur d'une meilleure coopération à l'échelle locale et internationale. Renforcer la production locale, développement de génériques, système de prix différenciés et flexibles, amélioration de la formation, favorables à des politiques de prix, échange de compétence et transfert de technologies.
Rôle/activité
Programme de partenariats hospitaliers Nord/Sud. L'initiative ESTHER est basée sur un partage d'expériences entre les pays pour permettre une prise en charge globale sur le traitement du VIH/Sida en favorisant des jumelages et des partenariats entre hôpitaux et établissements de santé d'Europe et des pays en développement afin combattre les inégalités d'accès aux soins dans les pays en développement.
Position
Pour un transfert et une décentralisation des technologies de soin, dans les respect des législations actuelles sans les contester.
Rôle
Médecins du Monde est une association humanitaire qui soigne les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles. Organisation non gouvernementale (ONG), Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l'homme et se bat pour améliorer la situation des populations.
Position
Dénonce le coût trop élevé des médicaments qui devraient être accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Contre les barrières commerciales et juridiques à la source de cette injustice, et pense que les accords dans le cadre du cycle de Doha n'ont pas été assez loin dans la dérogation aux monopoles de certains brevets pour la production de génériques à un prix accessible.
Rôle
Oxfam est une association internationale de 14 organisations travaillant ensemble dans 98 pays et en collaboration avec des partenaires et des alliés dans le monde entier pour trouver des solutions durables à la pauvreté et à l'injustice. Ils œuvrent directement avec les communautés et recherchent à influencer les plus puissants pour aider les populations dans le besoin à améliorer non seulement leurs vies et leurs moyens d'existence, mais aussi leur faire prendre part aux décisions qui les touchent.
Position
Ils souhaitent réduire les délais nécessaires à ce que des produits compétitifs atteignent le marché, élément clef d'une stratégie destinée à rendre abordable les vaccins pour les pays en développement et les donateurs. De plus, le système de R&D actuel, tourné vers le marché, a échoué à développer des vaccins pour des maladies comme la tuberculose ou le paludisme, qui touchent un grand nombre de personnes, de même que des vaccins qui seraient destinés à des marchés plus réduits, tel que celui contre la dengue.
Rôle
Médecins Sans Frontières est une association médicale humanitaire internationale, créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes. MSF apporte son aide à ceux dont la survie est menacée par des crises dues à la violence ou à la négligence cynique d'autres hommes. Elle délivre ses secours en toute indépendance et impartialité et se réserve le droit de s'exprimer publiquement sur les situations dont ses équipes peuvent être témoin.
Position
La croissance du nombre de brevets n'a pas favorisé l'innovation. MSF appelle les laboratoires pharmaceutiques à mettre leurs brevets en commun et prendre ainsi des mesures efficaces pour permettre l'accès à des médicaments essentiels à destination des personnes infectées par le VIH dans les pays en développement.
Rôle
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une institution financière internationale qui investit pour sauver des vies. À ce jour, le Fonds mondial a engagé 21.7 milliards de dollars US dans 150 pays pour soutenir des programmes de prévention, de traitement et de soins à grande échelle contre les trois maladies.
Position
L'augmentation considérable des ressources allouées à la santé ces huit dernières années au travers de l'aide au développement et d'autres sources est en train de modifier la façon dont le sida, la tuberculose, le paludisme, ainsi que d'autres problèmes de santé, évoluent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Peu de temps après son lancement, le Fonds mondial est devenu le principal organisme de collecte de fonds multilatéral pour la santé dans le monde. Il fournit les deux tiers du financement international pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme et un cinquième de celui consacré à la lutte contre le sida.
Rôle
UNITAID est une Facilité internationale d'achats de médicaments, chargée de centraliser les achats de traitements médicamenteux afin d'obtenir les meilleurs prix possibles, en particulier à destination des pays en voie de développement. UNITAID est financé par une taxe de solidarité sur les billets d'avion, adoptée par certains pays. Cet impôt a été proposé au départ par les présidents français Jacques Chirac et brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. UNITAID a été créée en septembre 2006, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
Position
L'action d'UNITAID se concentre sur la recherche de solutions pour combler les lacunes de l'allocution des médicaments les plus nécessaires. Cette opération de financements innovants est destinée à lutter principalement contre les pandémies (sida, paludisme, tuberculose) à l'origine de 6 millions de morts par an dans le monde. Les premiers résultats de UNITAID sont très encourageants : il a notamment réussi à faire baisser de 40% le prix des traitements contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour les enfants. Son budget pour 2007 dépassait 300 millions US$, et les fonds d'Unitaid sont dépensés à 85% dans des pays à faible revenu
L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule l'innovation et contribue au développement économique tout en préservant l'intérêt général.
L'OMPI a été créée en 1967, en vertu de laquelle ses états membres lui ont donné pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde grâce à la coopération entre états et en collaboration avec d'autres organisations internationales. Elle a son siège à Genève (Suisse).
Pour l'OMPI, le fait que le système des brevets soit défavorable aux PED ou aux PMA qui devraient être exemptés des exigences internationales en matière de propriété intellectuelle, et notamment de la protection par brevet de certains médicaments, n'est qu'un mythe.
Elle estime qu'un système des brevets efficace assurant une protection adéquate, est un facteur d'encouragement indispensable à la créativité et à l'inventivité. Il est essentiel pour établir et maintenir un environnement commercial attractif, tout en aidant les pays à mettre en place et à renforcer leurs propres capacités et infrastructures de recherche, qui sont considérées par l'ONU (et autres) comme un facteur déterminant de la lutte contre le sida dans les pays les plus sévèrement touchés. Pour l'OMPI, ce système de propriété intellectuelle adapté constitue un élément essentiel du développement économique durable, lequel à terme contribue à briser le cercle vicieux de la pauvreté, à élever le niveau d'éducation et à améliorer les conditions de vie ainsi que les soins de santé dispensés à la population.
L'OMPI estime que les traités internationaux de propriété intellectuelle ne viole en aucun cas le droit fondamental d'accès aux médicaments indispensables.
L'OMPI appuie les initiatives prises par le Secrétaire général des Nations Unies et coopère avec l'Organisation mondiale de la santé, l'ONUSIDA, ainsi que l'Organisation mondiale du commerce dans des domaines où elle peut apporter son expérience et ses compétences spécialisées.
L'OMPI n'a pas pour mandat d'interpréter les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, lequel est administré par l'OMC. Elle continue toutefois, dans le cadre de ses attributions, de fournir une assistance technico-juridique aux pays concernant l'application de cet accord.
L'OMPI et l'OMC ont récemment lancé une initiative commune pour aider les pays les moins avancés à appliquer l'Accord sur les ADPIC et à utiliser la propriété intellectuelle comme un moyen de promotion du progrès technique, de croissance économique et de création de savoirs et de richesses. L'OMPI est convaincue que tous les pays en développement, grâce à une utilisation efficace du système des brevets, devraient être à même de stimuler les activités de recherche au niveau national et d'unir leurs efforts pour élaborer et fabriquer des médicaments contre le sida.
En apportant ce soutien, l'OMPI vise à aider tous les pays à tirer pleinement parti du système de propriété intellectuelle et du système des brevets pour en faire des outils de création de richesses et de développement culturel, considérant qu'un système de propriété intellectuelle adapté, respectant à la fois les besoins des créateurs et ceux des consommateurs, revêt une importance particulière dans le domaine de la santé.
L'OMPI estime que par leur aspect incitatif à la recherche et de divulgation d'informations importantes (qui peuvent ensuite contribuer à mener d'autres recherches), le système des brevets est essentiel aux objectifs de santé mondiaux, et qu'il en est même une clé de voûte.
Elle estime aussi qu'il est important de trouver un juste milieu entre les préoccupations de santé publique et les intérêts des titulaires de brevets et que cet équilibre existe au sein même du système actuel, notamment grâce à une souplesse suffisante des accords ADPIC, notamment pour le VIH/Sida.
Enfin, elle considère que les difficultés d'accès aux soins et aux médicaments dans certains pays sont essentiellement dues à des causes socio-économiques, comme par exemple, le fait que dans de nombreux pays, les médicaments essentiels ne font pas l'objet de brevets, et que leur prix reste néanmoins prohibitif pour la plupart de la population. Elle rappelle également que 95% des produits pharmaceutiques figurant sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont désormais dans “le domaine public”, mais que ceux-ci demeurent inaccessibles ou économiquement inabordables pour de nombreuses personnes. En effet, dans ces cas, le brevet ne joue pas nécessairement le rôle déterminant dans la fixation du prix des médicaments, lequel dépend en fait de bien d'autres facteurs, tels que le coût de la recherche-développement, de la production, de la distribution et de la commercialisation.
L'Organisation Mondiale de la Santé est l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé, du système des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères... Sa ligne directrice est que la santé est une responsabilité partagée qui suppose un accès équitable aux soins essentiels et la défense collective contre des menaces transnationales.
L'OMS s'est dotée d'une Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, l'Innovation et la Santé publique (CIPIH), adoptée par l'Assemblé mondiale de la Santé en 2003 afin de "[…] recueillir des données et des propositions auprès des différents acteurs concernés et publier une analyse des droits de propriété intellectuelle, de l'innovation et de la santé publique, y compris la question des mécanismes appropriés de financement et d'incitation pour la mise au point de nouveaux médicaments et autres produits contre les maladies qui touchent avant tout les pays en développement." en considérant que les droits de propriété intellectuelle sont importants pour l'innovation en santé publique et qu'ils sont l'un des facteurs qui déterminent l'accès aux médicaments.
La commission a pour but d'étudier les interfaces et les liens entre les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la santé publique et elle examine en profondeur les moyens de stimuler la création de nouveaux médicaments et d'autres réponses aux maladies qui touchent avant tout les pays en développement. Elle tient compte des effets que peuvent avoir les droits de propriété intellectuelle sur la promotion de l'innovation intéressante pour la santé publique, et des contributions que peuvent apporter à cette fin les mécanismes de financement ou d'incitation, y compris des dispositions institutionnelles.
Pour la CIPIH le système des brevets est un important moteur de promotion de la recherche et d'innovation dans le domaine des nouveaux médicaments et d'autres produits. Mais le système des brevets n'est que l'un des facteurs d'innovation. Les dépenses publiques consacrées à l'enseignement supérieur et à la recherche-développement sous-tendent les travaux du secteur privé dans la mise au point de médicaments et de produits et elles financent des recherches sanitaires importantes pour la santé publique qui ne sont pas effectuées par le secteur privé. Des fondations à but non lucratif financent de plus en plus les activités de recherche-développement concernant des maladies qui touchent surtout les pays en développement. De tels mécanismes de mécénat publics et privés sont à encourager pour la CIPIH qui estime que d'autres formes de mesures incitatives susceptibles de stimuler l'innovation, ou des modèles d'innovation nouveaux, doivent aussi être envisagées. Il conviendrait d'évaluer les priorités actuelles de la recherche, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement.
La CIPIH insiste sur l'importance des brevets en matière d'innovation et de publication des recherches. Elle est cependant consciente que les universitaires, les auteurs de rapports officiels et les usagers du système des brevets (y compris des chercheurs travaillant dans le domaine des vaccins et du traitement des maladies "négligées"), ont posé une série de questions concernant l'efficacité et la pertinence des mesures incitatives qu'offre le système des brevets, ou les améliorations dont elles auraient besoin pour répondre aux besoins des pays en développement. Elle est aussi consciente qu'il existe des interrogations au sujet des effets des droits de propriété intellectuelle sur l'accès aux médicaments, et ces thèmes font actuellement partie des sujets de travail de la CIPIH, qui pour le moment se contente de renvoyer en guise de réponse vers des articles universitaires, dont on peut donc penser qu'elle estime le contenu.
Cependant le rapport de la CIPIH de 2006, fait état d'une nécessaire adaptation du système actuel aux besoins de santé mondiale, du bienfait important des licences obligatoires (l'OMS encourage de manière générale les pays à tirer parti des flexibilités des Accords sur les ADPIC), ainsi que de l'existence de certaines alternatives liées aux brevets comme le transfert de droit de brevet, pouvoir de monopole, droits de traitement prioritaire, qui laissent présager que l'OMS reste très ouverte à une évolution du système actuel.
Il y a plusieurs manières de considérer l'Organisation mondiale du commerce. C'est une organisation qui s'occupe de l'ouverture commerciale. C'est une enceinte où les gouvernements négocient des accords commerciaux. C'est un lieu où ils règlent leurs différends commerciaux. C'est une organisation qui administre un ensemble de règles commerciales.
L'OMC est donc essentiellement un lieu où les gouvernements Membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les opposent.
L'Organisation Mondiale du Commerce estime que les questions liées au commerce et à la santé publique figurent en bonne place dans son programme et des progrès notables ont été réalisés récemment. Pour elle, le fait qu'à Doha, la communauté internationale ait approuvé la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique est la preuve très concrète de la volonté des gouvernements de faire en sorte que le système commercial fondé sur des règles soit compatible avec les intérêts en matière de santé publique. Elle est convaincue que e système commercial multilatéral peut largement contribuer à l'amélioration du bien-être dans le monde. C'est dans cette volonté qu'elle a conclut l'Accords sur les ADPIC, visant a établir des normes internationales de propriété intellectuelle afin de promouvoir et de faciliter le libre échange.
L'Accord sur les ADPIC couvre ainsi certains domaines qui ont un rapport avec la santé et notamment avec la question de la protection conférée par les brevets de produits pharmaceutiques. L'accord sur les ADPIC oblige les 140 gouvernements membres de l'OMC à assurer pendant 20 ans la protection par copyright et par brevet d'un ensemble varié de nouveaux produits, parmi lesquels figurent les produits pharmaceutiques. Pendant cette période, personne ne peut utiliser, fabriquer ou vendre un produit sans l'autorisation de son inventeur.
Dans ce domaine, il est très important de trouver un juste équilibre entre deux objectifs complémentaires de la santé publique: encourager l'invention de nouveaux médicaments et permettre l'acquisition des médicaments existants à un prix abordable. Pour l'OMC, l'Accord sur les ADPIC a pour but d'aider à instaurer un tel équilibre: Il contient plusieurs dispositions qui donnent aux gouvernements le pouvoir de mettre en œuvre leur régime de propriété intellectuelle de façon à tenir compte de considérations immédiates et à plus long terme en matière de santé publique. L'OMC estime aussi qu'il offre une souplesse suffisante pour sa mise en œuvre en autorisant les pays à limiter, sous certaines conditions, les droits exclusifs des titulaires de brevets, en délivrant par exemple des licences obligatoires et en autorisant l'importation parallèle de produits brevetés. Cette souplesse a été réaffirmée par les Membres de l'OMC à la Conférence ministérielle de Doha.
L'OMS estime qu'actuellement le tiers de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments essentiels et que plus de 50 pour cent des habitants des pays pauvres d'Afrique et d'Asie n'ont même pas accès aux médicaments essentiels les plus élémentaires. L'accès aux médicaments essentiels et aux vaccins dépend de quatre éléments déterminants selon elle: sélection et utilisation rationnelles, financement durable, systèmes d'approvisionnement fiables et prix abordables.
Certains Accords de l'OMC peuvent influer sur le prix des médicaments. Ainsi, l'OMC estime que la suppression ou l'abaissement des droits d'importation sur les médicaments, les vaccins ou d'autres fournitures médicales qui peut résulter des négociations menées à l'OMC peut faire baisser les prix. Elle reconnait cependant que l'Accord sur les ADPIC initialement prévu pour encourager la R&D axée sur de nouveaux médicaments, puisse provoquer une hausse des prix en raison d'une protection plus stricte par les brevets. A cet égard, l'OMC rappelle que l'Accord autorise les Membres de l'OMC à appliquer, dans certaines circonstances, des mesures de sauvegarde telles que la concession de licences obligatoires et l'importation parallèle, dont la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique a permis de clarifier les conditions d'applications.
L'OMC estime de plus que la flexibilité de l'Accord sur les ADPIC permet de faire face au problème de l'accès aux médicaments et de leur prix, notamment en permettant la fixation de prix différenciés qui serait un moyen de faire en sorte que les prix soient le plus bas possible dans les pays pauvres, tandis que les prix plus élevés dans les pays riches continuent à encourager la R&D.
Enfin l'OMC soutient que les règles et les dispositions des Accords de l'OMC qui se rapportent le plus à la santé permettent généralement aux pays de gérer le commerce des biens et services de façon à atteindre leurs objectifs de santé publique, pourvu que les mesures relatives à la santé soient conformes aux principes fondamentaux du commerce tels que la non-discrimination.
Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le changement, et relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Nous sommes présents sur le terrain dans 166 pays, les aidant à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour renforcer leurs capacités, ces pays peuvent s'appuyer à tout moment sur le personnel du PNUD et son large éventail de partenaires. II est de loin la composante du paysage des Nations Unies la plus résolument en faveur de la baisse du pouvoir de monopole induit par les brevets en matière de santé, afin d'abaisser les coûts de vente. Il soutient donc théoriquement les systèmes alternatifs de propriété intellectuelle fondé sur la récompense. Néanmoins, son action se limite au champ pratique via la mise en place de politiques d'aides.
Son action dans le domaine de la santé concerne essentiellement le VIH/Sida, en partenariat avec l'ONUSIDA, et il exhortent les pays à recourir aux flexibilités en matière de propriété intellectuelle et de commerce de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique afin de réduire le prix des médicaments antirétroviraux pour en faciliter l'accès à ceux qui en ont le plus besoin. Il estime que les pays doivent utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition pour garantir la durabilité et un élargissement substantielle de la mise en place des services anti-VIH et atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.
D'après Jeffrey O'Malley, Directeur du groupe VIH/sida au PNUD, «L'utilisation des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC permettra aux pays de délivrer des licences obligatoires et de recourir à d'autres mécanismes prévus par ce même accord et par la Déclaration de Doha pour obtenir l'accès à des médicaments antirétroviraux génériques abordables. Un pays pourrait ainsi être en mesure de produire des médicaments génériques à moindre coût ou, s'il ne dispose pas de capacité de fabrication, d'importer des médicaments génériques moins chers d'un autre pays.»
Le PNUD considère par exemple qu'au Brésil, les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC ont permis de délivrer une licence obligatoire sur l'éfavirenz et de diminuer de plus de deux tiers le prix du médicament ; la dose de la version générique est ainsi vendue à 0,45 USD au lieu de 1,60 USD. Il affirme que de telles différences de prix ont de profondes répercussions sur la capacité des autorités nationales et d'autres fournisseurs de services à distribuer les traitements antirétroviraux à ceux qui en ont besoin.
Malgré les possibilités offertes par les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC, le PNUD estime que de nombreux pays n'ont pas encore revu leur législation afin d'y intégrer ces flexibilités et se propose d'aider les pays qui en feront la demande à renforcer l'accès au traitement et à leur fournir une aide technique visant à utiliser les flexibilités de l'Accord sur les ADPIC afin d'élargir l'accès aux médicaments antirétroviraux pouvant sauver des vies.
Le PNUD et l'ONUSIDA se positionnent donc clairement en faveur d'une généralisation des Licences Obligatoires, et se déclarent publiquement en faveur de toute alternative ou tout mécanisme permettant le développement d'un meilleur accès aux soins.
Il défend les intérêts économiques et compétitifs des Etats-Unis et donc les intérêts des grands laboratoires et firmes multinationales du pharmaceutique de nationalité américaine. Il partage donc les mêmes positions que les laboratoires pharmaceutiques, à savoir un maintien voire un renforcement des droits de propriété intellectuelle et du système des brevets. C’est le seul Gouvernement qui n’a pas traduit dans son droit la possibilité d’émettre des licences obligatoires afin de produire des génériques pour les pays qui en éprouvent le besoin.
Dès les années 1970, un réseau d’influence conduit par une dizaine de compagnies étatsuniennes (industrie pharmaceutique, informatique et entreprises du spectacle, principalement) se tisse et milite pour l’intégration de la propriété intellectuelle dans le cadre des politiques commerciales du gouvernement des États-Unis et la nécessité d’imposer un régime international de protection de la propriété intellectuelle.
Ce processus initié et alimenté par le lobbying de représentants du secteur privé a finalement trouvé un relais étatique auprès de l’USTR (représentant américain au commerce) et a été intégré aux objectifs de la politique commerciale internationale des États-Unis.
Ainsi dans les années 90, les Etats-Unis ont persuadé un certain nombre de pays de renforcer leur droit de la propriété intellectuelle bien avant les dates butoirs fixées par l'OMC, en brandissant le spectre d'éventuelles sanctions commerciales. L'une des dispositions de la législation commerciale américaine autorisant Washington à imposer unilatéralement des sanctions contre les exportations d'un pays qui ne satisfait pas à certaines conditions.
Suite aux négociations, les standards voulus aux États-Unis se sont donc imposés à un nombre croissant de pays, d’autant plus facilement depuis le Trade Act d’août 2002 qui donnait au président Bush les moyens d’accélérer les négociations. C’est ainsi que le gouvernement américain a pu infléchir, via des accords bilatéraux avec les pays concernés, aux accords de l’OMC des dispositions plus dures qui leur étaient favorables.
Finalement, les accords adoptés ne sont que des seuils minimum de protection que les pays signataires s’engagent à appliquer, auxquels les Etats-Unis ajoutent leurs exigences. C’est précisément ce qu’il s’est passé pour les ADPIC, de sorte que les pays du Sud, producteurs de génériques et donc potentiellement menaçants se sont vus appliquer des accords plus rigides, désignés ADPIC +. Face à de telles pressions, les petits sont bien démunis, en particulier les pays peu développés d’Amérique centrale et d’Amerique latine dont l’économie est très dépendante du marché américain.
Quelles sont ces mesures « ADPIC+ » ?
Dans le cadre de ces accords commerciaux de libre-échange, les dispositions «ADPIC+ » requises imposent non seulement aux pays signataires qu’ils mettent en œuvre des standards plus contraignants que ceux de l’Accord sur les ADPIC, elles limitent également le recours à un certain nombre de flexibilités prévues par cet Accord et clarifiées par la déclaration de Doha.
Ces dispositions « ADPIC+ » concernent notamment : l’allongement des durées de protection par les brevets au delà des 20 ans requis par l’OMC (sous divers prétextes) ; l’assouplissement des critères de brevetabilité ou leur élargissement ; des limitations sur les licences obligatoires, les importations parallèles; l’établissement d’un lien entre dispensation de brevets et obtention d’autorisation de mise sur le marché.
Le Brésil a été accusé par les Etats-Unis de contrevenir aux dispositions des ADPIC. Aux yeux du gouvernement américain, les lois brésiliennes entraînent une discrimination à l'encontre des détenteurs étrangers de brevets. Conformément à une de ses lois visant à renforcer l'industrie pharmaceutique nationale et à réduire le prix des médicaments, le Brésil ne respecte un brevet que si le médicament en question est produit localement. Les compagnies étrangères doivent donc s'implanter au Brésil pour bénéficier de cette protection. L'affaire est maintenant devant le système de règlement des différends de l'OMC.
Ces accords attestent d’un serein mépris à l’égard des engagements pris en 2001 à Doha et vis-à-vis des malades des pays pauvres. C’est sans doute la raison pour laquelle le débat sur l’accès aux médicaments et la propriété intellectuelle doit aujourd’hui reprendre le devant de la scène internationale. Il est peut-être temps que l’Organisation Mondiale du Commerce condamne la politique
des États-Unis.
Rôle :
La Commission européenne représente l'intérêt général de l'UE. Elle joue un rôle moteur dans l'élaboration de la législation, dans la gestion et la mise en œuvre des politiques européennes, dans le contrôle de l'application du droit européen et dans les négociations menées par l'UE sur la scène internationale. Par l’intermédiaire de l’Office européen des brevets qui est une autorité européenne de recensement des brevets, l’UE travaille en étroite collaboration avec l’OMPI, et se voit délégué certaines de ses taches.
Situation sanitaire de l’UE
L’état de santé de la population de la Région européenne de s’est amélioré au cours des dernières décennies, comme en témoigne l’allongement de l’espérance de vie à la naissance. Il existe néanmoins de fortes inégalités de longévité qui, toujours croissantes, sont liées à des facteurs socioéconomiques et sexospécifiques. Les infrastructures de santé et la couverture sociale des habitants européens figurent parmi les meilleures au monde.
Position :
Les États membres de la Communauté européenne délivrent des brevets en conformité de leurs lois nationales. En règle générale, la durée des brevets est de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En faveur d’un respect des droits de propriété intellectuelle, dont ils sont convaincus des bienfaits et du rôle positif dans la croissance des pays, ils sont fermement opposés à tout contournement de ces droits de propriété intellectuelle (principalement illégaux, comme la contrefaçon).
Propositions :
L’importance que l’industrie pharmaceutique accorde à la protection par les brevets est attestée par le fait que plusieurs multinationales pharmaceutiques figurent parmi les principales détentrices de brevets, et aussi par le fait que la recherche est concentrée dans les pays qui offrent une bonne protection par brevet. Le nombre de pays qui ont pris des mesures de prolongation de la durée des brevets montre bien que les gouvernements estiment que la protection par les brevets est cruciale. Convaincus que ces mesures créeront un climat favorable à la recherche-développement dans le secteur pharmaceutique, un marché fortement concurrentiel dans le monde les pays membres de la Communauté européenne ont adopté des lois pour prolonger la vie effective des brevets pharmaceutiques et ainsi compenser les délais importants pour répondre aux exigences réglementaires.
La Commission de la Communauté européenne a ainsi présenté en 1990 un projet de prolongation de brevets. Craignant que les sociétés pharmaceutiques innovatrices en Europe soient moins bien protégées que leurs concurrentes américaines et japonaises, la Commission a proposé des prolongations maximales de 10 ans, mais n’excédant pas 16 ans suivant l’approbation de la commercialisation du médicament. Un des principaux objectifs de la Commission est l’harmonisation des lois partout dans la Communauté pour ne pas créer de disparités entre les États membres ou d’entraves à la libre circulation des médicaments dans la Communauté européenne. En juin 1992, le Conseil des Communautés européennes a pris un règlement permettant une protection additionnelle des brevets pharmaceutiques. Le règlement, qui diffère de la proposition originale de la Commission, permet la prolongation des brevets pharmaceutiques d’un maximum de cinq ans afin que le breveté jouisse d’une exclusivité globale maximale de 15 ans à partir de la mise en marché du médicament.
L’UE est globalement en faveur des licences obligatoires et à travers son office des brevets, a entamé une coopération avec les pays en développement et les moins avancés facilitant de manière relative le transfert de propriété intellectuelle.
Liens essentiels :1, 2
Rôle :
L’« entreprise de santé publique » au Canada ressemble à celle des États-Unis dans la mesure où le rôle directeur (y compris la majeure partie du mandat législatif) est entre les mains des provinces ou des états. La plupart des lois régissant la santé publique sont provinciales, mais les organismes fédéraux ou locaux jouent aussi un rôle important.
Situation sanitaire du pays : Les infrastructures médicales y sont excellentes mais chères. En considérant des mesures telles l’espérance de vie totale et l’espérance de vie d’un individu en bonne santé, on constate que la situation sanitaire du Canada continue de s’améliorer et de dépasser celle de nombreux pays. Même si de nombreuses difficultés subsistent pour les maladies infectieuses – notamment les menaces de pandémie de grippe et les tendances inquiétantes concernant le VIH (virus d'immunodéficience humaine), le syndrome d'immunodéficience acquise (sida), la syphilis, les organismes résistants aux antibiotiques et autres infections nosocomiales – la majeure partie du fardeau de la « mauvaise santé » et de la mortalité est liée aux maladies chroniques.
Position :
Le Canada a aboli le système de licence obligatoire pour les produits pharmaceutiques qui avait promu une industrie du générique florissante et les brevetés bénéficient maintenant de l’exclusivité du marché aussi longtemps que le brevet est valide; cependant, il n’a pas encore envisagé de prolonger la durée des brevets. Il faudra peut-être qu’il envisage cette option s’il veut préserver un contexte législatif pour les brevets pharmaceutiques qui rivalise avec celui des autres grandes nations industrialisées, mais en parallèle, le Canada s’ouvre par des accords bilatéraux aux fabricants des pays en développement et a été le premier pays a déposé officiellement une licence obligatoire en 2007 pour l’exportation au Rwanda de traitements antirétroviraux.
Propositions :
La Loi sur les brevets en vigueur au Canada a toujours eu des dispositions très particulières en ce qui concerne les médicaments. Ainsi, jusqu'à tout récemment, il était impossible d'obtenir un brevet au Canada sur un médicament en tant que tel. On ne pouvait breveter que son procédé de préparation. Ceci était bien sûr très restrictif, puisque le titulaire du brevet ne pouvait empêcher une tierce personne de fabriquer ou d'importer le même médicament lorsque ce dernier était préparé par un autre procédé. En 1989, ceci a toutefois été modifié et il est désormais possible de protéger par brevet:
- un nouveau médicament, et ce, indépendamment de son procédé de préparation;
- un nouveau procédé de préparation d'un médicament, que ce dernier soit nouveau ou non;
- une nouvelle composition pharmaceutique, dont l'originalité réside soit dans la formulation, soit dans le choix du principe actif; ou encore
- une nouvelle indication thérapeutique pour un médicament déjà connu.
Le Canada infléchit donc vers une meilleure protection de son système interne pour rattraper la concurrence internationale mais adopte toujours des statuts spéciaux avec les pays en développement pour une production plus équitable.
Liens essentiels : 1, 2
Rôle :
L’Inde dispose de l’industrie pharmaceutique la plus avancée des pays en développement (en particulier en ce qui concerne les produits finis de haute qualité).
Situation sanitaire du pays :
L’espérence de vie en Inde est de 65,8 ans pour les femmes et de 64,1 ans pour les hommes, elle est en augmentation corrélée avec la baisse du taux de mortalité, l’amélioration de la quantité et de la qualité des services. Cependant, il y a d’importantes variations suivant les états, les quartiers, les zones urbaines ou rurales, cela étant du au faible taux d’alphabétisation, aux revenus mais aussi aux conditions sociaux-économiques. D’après les rapports les plus récents, les principales causes de mortalité en Inde sont les maladies non-transmissibles (tumeurs, diabètes, maladies cardiovasculaires) puis les maladies transmissibles (infectieuses et parasitaires) et enfin les blessures.
Position :
L’Inde a la particularité d’être un des rares pays en voie de développement a disposer de capacités de production de médicaments importantes. S’appuyant sur une réglementation stricte concernant l’attribution des brevets des produits pharmaceutiques, c’est légalement que les “génériqueurs” indiens exportent les leurs. Autrefois les lois indiennes ignoraient les brevets. Mais avec l’accord sur les ADPIC selon lequel un brevet accordé à une firme pharmaceutique est valable pendant vingt ans, cette posture a changé. L’accord ADPIC peut toutefois être contourné avec les licences obligatoires. Particularité indienne, celles-ci sont automatiques pour les génériqueurs ayant fait des “investissements significatifs”. C’est pourquoi l’Inde est toujours la “Pharmacie du Monde en Développement”.
Propositions :
Pendant longtemps, le pays a produit les médicaments que ses savants et techniciens savaient produire sans se préoccuper outre mesure de l’éventuelle propriété de tel ou tel procédé ou substance. Utilisés localement, ces médicaments étaient aussi exportés vers d’autres pays pauvres où il est impossible de payer les prix pratiqués pour ces médicaments dans les pays occidentaux. Mais, membre de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), l’Inde a subi forte pression pour se mettre en conformité avec les règles de l’organisation qui oblige ses membres à honorer les demandes de brevets formulées par les firmes pour les produits technologiques, y compris les médicaments. C’est pourquoi, en 2005, l’Inde a accepté de revoir sa législation sur les brevets.
Toutefois, s’appuyant sur la déclaration de Doha, qui indique que les accords qui lient les membres de l’OMC « peuvent et doivent être interprétés et appliqués de manière à respecter le droit de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès aux médicaments pour tous », l’Inde restreint, dans sa législation Section 3(d), le champ de la brevetabilité en précisant que des brevets ne seraient accepter que pour les seules substances nouvelles et non pour de nouvelles formes ou de nouveaux usages de substance déjà connues. Par ce biais, reste possible, en Inde, la fabrication de génériques à des coûts considérablement réduits. L’Inde a pu attendre le dernier moment pour appliquer les accords ADPIC de l’OMC ce qui lui a permis de faire exploser leur production de génériques. Leurs usines sont agrémentées par la Food and drug administration (FDA) américaine, et elles commercialisent leurs produits dans les pays riches lorsque les brevets arrivent à expiration (les ventes des génériques aux Etats-Unis représentent déjà plus de la moitié de leur chiffre d’affaires). Les cinq dernières années, les pays riches ont vu des produits réalisant un total de 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires aujourd’hui tomber dans le domaine public, et être génériqués (à titre de comparaison, le chiffre d’affaires du médicament en Inde s’élève à l’heure actuelle à moins de 9 milliards de dollars). Or, du fait qu’elles fabriquaient déjà des versions génériques de ces produits dans leurs usines estampillées FDA, les firmes indiennes ont été dans une position idéale pour remporter les énormes marchés qui s’annoncent au Nord. Pour défendre leur accès à ces marchés, les génériqueurs indiens étaient prêts à tous les sacrifices et n’ont pas hésité à soutenir publiquement le souhait des pays riches que l’Inde adopte un régime de monopoles pharmaceutiques bien plus strict que l’OMC ne l’y oblige).
Les fabricants indiens de médicaments génériques veulent eux aussi faire du profit, mais leurs prix défient ceux des firmes pharmaceutiques ayant développé et breveté les “princeps” de ces produits. C’est donc grâce à eux que les bailleurs internationaux assurent l’accès des populations, déjà insuffisant, aux traitements du VIH dans les pays pauvres et émergents.
Liens essentiels : 1
Rôle :
La Thaïlande fait partie des pays qui autorisent des entreprises à produire des versions génériques de médicaments ayant été brevetés dans des pays industrialisés, à l'aide de méthodes de production différentes de celles mises au point par les fabricants d'origine.
Situation sanitaire du pays : La transition épidémiologique est en cours. La prospérité croissante de la Thaïlande se traduit par une amélioration globale de l’état de santé des populations et s’accompagne de mutations dans la structure de la morbidité, surtout au niveau des affections chroniques et des besoins supplémentaires en soins de santé. Les maladies transmissibles (paludisme, VIH/sida et tuberculose) demeurent des priorités. S’agissant du paludisme, la situation est inquiétante le long de la frontière avec le Myanmar, exacerbée par une prévalence élevée de la résistance aux antipaludiques et par les mouvements perpétuels de populations aux frontières. De plus, Les maladies non-transmissibles augmentent.
Position :
Le gouvernement thaïlandais souhaite apparemment revenir sur la politique audacieuse de licences obligatoires qui avait été mise en place après le coup d’état militaire de 2006, et s’orienter davantage vers la négociation d’accords avec les laboratoires et les grandes firmes pharmaceutiques américaines.
Propositions :
En novembre 2006, le ministre de la Santé publique thaïlandais Mongkol Na Songkhla avait provoqué la colère de certains fabricants de médicaments, en permettant l’application de licences obligatoires sur trois médicaments, autorisant la fabrication locale de génériques beaucoup moins coûteux contre le sida. C’était la première fois que la Thaïlande utilisait un outil juridique autorisé en vertu de la loi sur les brevets et inscrit par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans les Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC). Mais cette utilisation, saluée par la plupart des ONG comme une avancée importante, était-elle vraiment nécessaire ? La licence obligatoire est une mesure controversée en vertu de laquelle le gouvernement peut divulguer les formules de médicaments brevetés par des sociétés étrangères, afin que les médicaments puissent être produits et distribués à moindre coût et en temps utile. La Thailande peut-elle prétendre aux conditions d’applications des licences obligatoires, qui suppose une véritable urgence sanitaire et un manque de moyens critique ?
Le Kaletra fait partie des médicaments les plus utilisés dans le traitement du VIH/sida, car certains patients développent en effet une résistance aux antirétroviraux traditionnels et ont besoin d’une nouvelle catégorie de médicaments appelés « de deuxième intention ». En Thaïlande, ces médicaments peuvent coûter jusqu’à vingt-deux fois plus cher que les ARV traditionnels, et la Thailande n’est pas considéré à proprement parler comme un pays pauvre. De fait les pays à revenu moyen, comme la Thaïlande, sont dans une position inconfortable : ils ont aussi besoin de médicaments au moindre cout, mais en raison de la capacité de production dont ils disposent, ils subissent les pressions des entreprises pharmaceutiques, appuyées par le gouvernement américain, pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle. Peu de temps après l’octroi de la licence obligatoire, sur ces deux médicaments fabriqués par des firmes américaines, le gouvernement des États-Unis avait inscrit la Thaïlande sur la liste de surveillance prioritaire des pays suspects en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Une mesure qui est loin d’être anodine puisqu’elle peut entrainer le retrait des privilèges commerciaux accordés par les États-Unis. En théorie les deux décisions ne sont pas liées, mais beaucoup d’experts de la santé et du commerce on a vu cette mesure punitive, comme résultant de la position de la Thaïlande sur la question des brevets pharmaceutiques. Aujourd’hui le gouvernement d’Abhisit Vejjajiva tente de revenir sur cette question avec une attitude plus conciliante : le but étant évidemment de préserver la voie vers les exportations américaines. Dans cette optique le Ministère du Commerce, le Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) et la Biotechnology Industry Organisation (BIO) ont convenu du principe d’améliorer l’accès à des médicaments moins chers pour les Thaïlandais, mais en encourageant la coopération sur la recherche et l’innovation, plutôt que d’imposer des licences obligatoires. La coopération en matière de recherche et de développement permettrait d’assurer à la Thaïlande la capacité de produire moins cher, des médicaments de qualité, tout en minimisant la controverse entre le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques. Le principe étant fixé pour l’avenir, que les licences obligatoires seront utilisées par le gouvernement thaïlandais que comme un dernier recours.
Liens essentiels : 1, 2
Rôle :
L’Afrique du Sud est le premier pays a avoir gagné un bataille contre les trusts pharmaceutiques. Comme le Brésil, ce pays a contourné les accords ADPIC jusqu’à la dernière échéance. Ce pays est un acteur central par sa population majoritairement affectée par le VIH et par son industrie du générique qui lutte contre les limitations internationales.
Situation sanitaire du pays : En Afrique du Sud, 1 personne sur 10 est séropositive. La situation sanitaire est aussi dramatique que les données sur l'incidence de la maladie. Le sida est l'une des premières causes de mortalité dans l'ensemble du pays. Selon l'étude nationale du Centre de recherches en sciences humaines (HRSC), 10,9 % des Sud-Africains âgés de deux ans et plus en sont atteints. Sur une population totale d'environ 50 millions d'habitants, c'est près de 5,7 millions de Sud-Africains qui étaient infectés en 2007, dont 2,5% d'enfants âgés de moins de 14 ans. Un chiffre qui fait de l'Afrique du Sud le pays le plus touché au monde par ce virus.
Position :
L’Afrique du Sud, qui fait face à un taux catastrophique d’incidence du VIH, s’est lancée dans la manufacture d’antirétroviraux encore brevetés pour affronter l’épidémie, mais a aussi dû affronter des poursuites de 39 sociétés pharmaceutiques. Ce cas suivait l’adoption de l’accord sur les ADPIC par l’OMC, dont les clauses permettaient d’empêcher les États de faire valoir des considérations de santé publique dans l’élaboration de politiques sur les brevets pharmaceutiques.
Propositions :
En adoptant en 1997 la Medicines Act (loi sur les médicaments), l'Afrique du Sud a "inscrit dans ses lois les exemptions permises par les ADPIC, en permettant d'octroyer des licences obligatoires. Mais cela ne s'applique qu'à des produits pharmaceutiques."
La législation pharmaceutique adoptée en Afrique du Sud en 1997 a limité les droits des détenteurs de brevets en autorisant les importations parallèles et en modifiant les conditions d’enregistrement des médicaments. Les firmes américaines ont alors contesté ces dispositions, les accusant de violer les règles de l’OMC, puis la controverse avait semblé s’aplanir. Ce n’était qu’un faux-semblant : 19 firmes pharmaceutiques portaient plainte en 1998 contre le Gouvernement sud-africain devant la justice de son pays, prétendant que cette législation n’était pas conforme à la constitution nationale. Ces firmes étaient soutenues dans cette voie par le Gouvernement américain et par la Commission Européenne. Le procès, fixé enfin au 3 mars 2001 devant la Haute Cour de Pretoria, a été ajourné au 18 avril 2001 par le président de la Cour, afin d’introduire en défense les associations qui luttent pour l’accès des malades aux traitements. Durant cet intervalle, les actions se sont multipliées pour faire pression sur les firmes et sensibiliser l’opinion internationale ; par exemple, Médecins sans frontières a rassemblé près de 300 000 signatures venant de 132 pays à la pétition lancée sur le thème “la protection des vies humaines doit passer avant celle des brevets”. La bataille judiciaire s’est terminée le 19 avril 2001 par le retrait de la plainte des 39 firmes, soucieuses de ne pas ternir davantage l’image déjà bien endommagée de l’industrie pharmaceutique. L’épilogue de Pretoria a été salué par les médias comme une “victoire des pauvres”. Cette victoire devrait ouvrir la voie vers des politiques de prix qui améliorent l’accessibilité des antirétroviraux, et des médicaments essentiels en général. Mais la prise en charge des millions de malades du sida représente un défi gigantesque, dans lequel la fourniture des médicaments spécifiques n’est pas le seul enjeu : une intervention plus large est nécessaire. Une “action globale de santé publique” est prévue dans l’initiative de l’Onusida et de ses partenaires pour “accélérer l’accès à la prise en charge de l’infection par le VIH”. La solidarité internationale devrait encore avoir l’occasion de se manifester.
Liens essentiels : 1, 2
Rôle :
L’Organisation des Nations Unies a établi une liste de «pays les moins avancés» (PMA), qui compte actuellement 50 pays. Cette liste est révisée tous les trois ans par le Conseil économique et social, à la lumière des recommandations du Comité des politiques de développement (CPD). Les critères appliqués pour établir la liste sont le faible revenu, l’insuffisance des ressources humaines et la forte vulnérabilité économique. Ces pays sont les plus touchés par les dysfonctionnements du système de brevets actuels et ont du mal à contourner la législation internationale.
Position :
L’Accord sur les ADPIC reconnaît qu’il serait difficile aux PMA d’appliquer immédiatement les normes très rigoureuses de protection des DPI et leur octroie en conséquence un délai de transition de dix ans, tout en prévoyant une assistance technique «en matière d’élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à la prévention des abus. L’Accord sur les ADPIC comporte plusieurs flexibilités — licences obligatoires, importations parallèles et utilisation ou commerce loyal auxquelles les PMA peuvent recourir pour concilier l’application de normes compatibles avec l’Accord sur les ADPIC et leur propre politique de réglementation des DPI. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement que cette flexibilité soit employée.
Premièrement, les PMA ne peuvent pas invoquer ces dispositions sans adopter une loi pour les transposer dans le droit national. Deuxièmement, bon nombre de flexibilités ne peuvent pas être utilisées dans les pays membres d’organisations régionales de protection des DPI. Troisièmement, certains pays ne peuvent pas y recourir en raison d’engagements bilatéraux.
Propositions :
Le Brésil est souvent cité comme un exemple que les pays africains pourraient suivre. "A l'exception de quelques pays qui ont déjà adopté des lois de protection des brevets, bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne pourraient produire des médicaments génériques ou procéder à des importations parallèles sans s'attirer les foudres des groupes pharmaceutiques", explique M. Mark Grayson du Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, un puissant groupe de pression qui a cherché à faire remonter les prix des médicaments en Afrique du Sud. "Seuls quelques pays africains, disposent de lois protégeant les brevets." Puisque l'accord sur les ADPIC prévoit une période de transition de 10 ans pour les pays qui n'accordaient pas de protection par brevet aux produits pharmaceutiques lors de l'entrée en vigueur de l'accord en 1995, la plupart des pays africains avaient jusqu'au début de l'année 2006 pour se mettre en conformité. Sur les 13 pays qui ont demandé à l'OMC de bénéficier de quelques années supplémentaires avant de devoir se conformer à l'accord sur les ADPIC, on ne compte aucun pays d'Afrique subsaharienne. "Ce qui est surprenant, c'est qu'aucun pays africain n'ait activement cherché à bénéficier des dispositifs de l'accord de l'OMC", explique M. Salih Booker, directeur général du groupe Africa Action, basé aux Etats-Unis.
Le fait est que Les PMA n’ont pas les compétences spécialisées ni les capacités administratives nécessaires pour appliquer l’Accord sur les ADPIC. En outre, la Déclaration de Doha de 2001, qui est un progrès par rapport à l’Accord sur les ADPIC, en particulier dans le domaine de la santé et de l’accès aux médicaments, ne règle pas la question du renforcement des capacités technologiques. Comme la plupart des PMA ne sont pas conscients de toutes les possibilités d’utilisation des flexibilités, il convient que l’OMPI, en coopération avec la CNUCED, prenne plus d’initiatives pour les en informer.
La majorité des PMA non africains protègent les produits pharmaceutiques par brevet en appliquant le régime de leur ex-colonisateur (Correa, 2007). Malgré le délai de transition, presque tous les PMA d’Afrique ont fait de même, notamment en ce qui concerne le brevetage des produits pharmaceutiques.
Dans l’esprit de l’article 66.1 de l’Accord sur les ADPIC et du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha de 2001, qui les exemptent de délivrer des brevets et de les faire respecter, ainsi que de la protection des données d’essai, ils ont la faculté de ne pas appliquer les brevets accordés et d’autoriser la concurrence sur le marché concerné. Des normes de protection des DPI plus rigoureuses ont été négociées dans des accords bilatéraux et régionaux. L’inclusion de ces clauses dites “ADPIC plus” limite encore la possibilité d’employer les flexibilités négociées au niveau multilatéral, comme en témoigne la prolifération d’accords de libre échange. Après plus de deux décennies de durcissement progressif de la protection des DPI, certains commencent à se demander si l’on n’est pas allé trop loin. De plus en plus, les pays en développement et notamment les PMA considèrent que la dimension développement n’est pas suffisamment prise en compte dans le régime mondial de protection des DPI. Le régime actuel de protection des DPI risque fort d’entraver, voire de bloquer toute stratégie de rattrapage, condamnant les pays pauvres à suivre un sentier de croissance à faible technologie et à faible valeur ajoutée et creusant ainsi le fossé des connaissances entre ces pays et les pays développés. Pour aller au-delà du régime actuel il faut envisager les DPI non comme une fin en soi mais comme un moyen de promouvoir le développement, la croissance et la réduction de la pauvreté. Dans les PMA, l’apprentissage sera articulé essentiellement autour de la capacité d’assimilation et d’adaptation de techniques existantes, c’est-à-dire l’imitation. Mais, dans la plupart des cas, un travail d’ingénierie inverse sera indispensable.
Lien essentiel : 1
Face à l’épidémie de Sida, le brésil a entamé une audacieuse politique d’accès aux soins. Pour cela, le gouvernement s’est retrouvé confronté au système nordique de propriété intellectuelle, imposé à tous depuis les accords d’ADPIC de 1994. Fort d’une situation économique avantageuse, le pays a alors entrepris de lutter contre le système des brevets dans l’ensemble des pays du Sud estimant que loin de menacer les industries pharmaceutiques du Nord, une libre circulation de génériques au sein du Sud est la seule et unique solution contre des épidémies comme celle du sida. Aujourd’hui ses succès sont réels, et de bon augure pour les adversaires des brevets, malgré une résistance importante des lobbys pharmaceutiques du Nord qui, persuadés de leur bon droit et droit international à l’appui, engagent de nombreux procès contre le Brésil, sa politique, et tous ceux qui semblent la suivre.
Si les accords des ADPIC de 1994, exigeants un alignement de tous les pays sur les systèmes de propriété intellectuelle des pays développés ont étés très difficile pour les pays les moins avancés dont l’économie n’étaient pas compatibles, ils ont aussi posé problème pour des pays plus développés comme le Brésil. D’autant que pour ces pays, grands producteurs de génériques et concurrents des industries du Nord, les exigences des ADPIC ont été appuyées par une demande particulièrement pressante des Etats-Unis afin de réduire les délais d’application, à un an par exemple pour le Brésil.
Ce n’est qu’en jouant sur une double « faille » ou exception à l’application des ADPIC, que le brésil a pu continuer son activité de production de génériques et que le programme d’accès au soin pour les malades du sida du président Lula a pu être promu. D’une part, les seuls ARV (anti rétroviral drugs) produits sous forme de générique sont ceux qui n’entraient pas dans la juridiction des ADPIC, c’est-à-dire ceux déjà commercialisés au Brésil, lorsque ce pays a modifié sa législation nationale sur les brevets pour se conformer aux nouvelles règles.
D’autre part, le brésil a nationalisé un certain nombre de laboratoires, de sorte que ces les laboratoires publics ont pu être efficacement mobilisés. Aussi le ministère de la Santé a-t’il pu procéder par contrats bilatéraux, en échappant, dans ce cas, à la règle d’approvisionnement par appels d’offre ouverts aux compétiteurs internationaux, imposée elle aussi par l’OMC.
En somme, cela n’était permis que grâce à une application souple des ADPIC. (Les seuls vrais freins au programme d’accès au soin de Lula étant les procès faits directement par les laboratoires américains s’estimant lésés et aux laboratoires brésiliens.)
Grace à cela le Brésil, a pu assuré la gratuité du traitement à 200 000 malades du sida.Le pays se félicite d'avoir divisé par deux le taux de mortalité des personnes atteintes et d’apporter à environ un tiers des séropositifs des ARV gratuits.
Toutefois cette politique bénéficiait du statut particulier du Brésil et s’est heurtée a de nombreuses limites. Notamment , l’article 31f des ADPIC proscrit la production de génériques à d’autres fins que l’alimentation du marché domestique. Ce qui signifie en clair l’interdiction de les exporter et donc pour d’autres pays de les importer. Autrement dit les pays les moins avancés n’ayant pas d’industrie de reproduction n’avait pas accès au génériques du tout, et même des pays comme le Brésil sont limités puisque certains médicaments contre le sida sont si complexes qu’ils ne peuvent pas être reproduits uniquement par les laboratoires brésiliens. Et la contrairement au marché interne, sur lequel un pays peut aisément faire régner sa loi, des touts petits pays ne peuvent rien faire contre l’interdiction internationale d’importer. Les accords internationaux comptent donc moins que l’économie relative des pays dans la régulation de la Proprieté Intellectuelle.
L’argument des firmes pharmaceutiques pour justifier l’interdiction d’exporter les génériques, est qu’ils constitueraient alors une concurrence non soutenable avec les médicaments brevetés. En détruisant les rentes que les médicaments brevetés permettent de prélever, les génériques menaceraient la recherche et les traitements futurs. L’avis du brésil sur la question est clair. Si ces arguments peuvent être entendus, dès lors que les génériques produits dans le Sud seraient autorisés à circuler dans les pays du Nord, ils sont sans valeur si cette circulation est circonscrite aux échanges Sud-Sud. Dans les pays du Sud en effet, l’absence de demande solvable aux prix où sont offerts les ARV sur les marchés occidentaux, ne saurait pénaliser les firmes détentrices de brevets. Dès lors, autoriser ces pays à importer des génériques, apparaît bien comme la seule solution leur permettant d’affronter l’épidémie.
La réunion de l’OMC à Doha en 2002 va alors constituer une rupture importante. Les pays qui n’ont pas d’industrie du tout ont désormais le droit d’importer, sous certaines conditions encore.
Le brésil en profite, en Mai 2007 le président Luiz Inacio Lula da Silva a décrété, pour la première fois, la "licence obligatoire" d'un médicament. La mesure suspend l'exclusivité du brevet du laboratoire Merck sur l'efavirenz, un médicament pour le sida utilisé par 75 000 malades, et autorise l'importation d'une version générique qui sera achetée en Inde 70 % moins cher. L'économie sera de 30 millions de dollars (22 millions d'euros) par an. Le Brésil versera à Merck, au titre du brevet, 1,5 % de ses dépenses en générique.
"Cette somme est trop faible pour compenser nos gros investissements de recherche", a évidemment commenté la direction brésilienne de Merck.
Les organisations non gouvernementales (ONG) liées au domaine médical ont applaudi la décision du gouvernement et elles espèrent que le Brésil servira d'exemple à ses voisins sud-américains. "Depuis que les licences obligatoires sont autorisées par l'OMC, peu de pays pauvres y ont recours, par peur de représailles", affirme Michel Lotrowska, représentant local de Médecins sans frontières (MSF).
Enfin le Brésil a aussi utilisé les avancées de Doha au profit des pays moins avancés et chapeauter leur transformation vis à vis du système global de propriété intellectuelle. A l’exemple du Mozambique. Le brésil a financé en 2010 la création d’une usine au pour des génériques contre le sida. Ajouté au transfert de technologie, le Brésil s'engage à garantir la qualité des médicaments.
Le Brésil trace donc sa propre voie au sein de la propriété intellectuelle internationale. Pour les adversaires du brevet sa démarche illustre les limites de ce dernier mais aussi les alternatives optimistes qui se profilent actuellement. Toutefois, des exemples de ce type sont pour l’instant limités. Il faut noter que le Brésil d’une position économique avantageuse. Le gouvernement les achète en grande quantité et a donc une bonne marge de négociation dans les rapports de force. Mais ce n’est pas le cas de pays comme le Chili ou le Mexique qui les payent cinq ou sept fois plus chers car ils sont dépendants d’accords commerciaux avec les Etats-Unis.
Célèbre économiste diplomé de Harvard puis professeur au MIT et Harvard il s'intéresse aux questions de coopération internationale, d'évaluation des politiques publiques et de développement. Il est l'origine de la proposition de garantie de marché qui selon Robert Borro, l'un des spécialistes de l'étude de la croissance économique, devraient apporter une contribution sans précédent à l'amélioration de la santé dans les pays les plus démunis de la planète, Mich&ælig;l Kremer propose un traitement des problèmes sanitaires dans le monde par un retour en puissance de la vaccination.
Ses nombreuses publications sur les questions d'accès aux soins:
"Advance Market Commitments for Vaccines Against Neglected Diseases: Estimating Costs and Effectiveness,?" with Ernst Berndt, Rachel Glennerster, Jean Lee, Ruth Levine, Georg Weizs?er, and Heidi Williams, forthcoming in Health Economics.
"Creating Markets for Vaccines" (with Rachel Glennerster and Heidi Williams), Innovations, 2006, 1(1): 67-79.
"Advance Market Commitments: A Policy to Stimulate Investment in Vaccines for Neglected Diseases", (with Owen Barder and Heidi Williams), in The Economists' Voice.
"The Price of Life", (with Rachel Glennerster and Heidi Williams) Foreign Policy May/June 2005: 26-27.
Originaire du Brésil, il est Docteur en Droit de l'Université de Paris I et professeur au Centre Universitaire de Brasilia.
Selon lui, l'accord ADPIC n'est pas bénéfique aux pays du Sud parce que ceux-ci ne produisent pas de technologie. Dans un contexte d'expansion des échanges et des inégalités internationales, les normes de propriété intellectuelle ne stimulent pas l'innovation technologique au Sud. Tout au contraire, elles augmentent la dépendance technologique et le flux financier du Sud vers le Nord. Selon Marcello dias Varella les pays du Sud n'ont pas les moyens de produire de nouvelles technologies, et le manque de possibilités d'investissement accroit l'inégalité entre les régions. Le système de brevets actuel ne rempli pas sa fonction optimale.
Publications :
VARELLA, Marcelo Dias. "Point de vue: L'organisation mondiale du commerce, les brevets, les médicaments et le rapport nord-sud : un point de vue du sud." Revue internationale de droit économique 2004/1 (t. XVIII, 1).
Patrice Trouiller dénonce l'écart entre les progrès médicaux des pays du Nord et leur faible diffusion, puisque plus des deux tiers de la population mondiale en est privée. Il prône un retour à une médecine plus proche des problèmes sanitaires mondiaux et pour cela affirme que l'unique ressort est celui de la coopération internationale. Elle doit mettre en vigueur des plans d'actions pratiques et travailler une refonte générale du système de la propriété intellectuelle.
Publication:
"Diffusion et accès à l'innovaton médicale dans les pays en voie de développement, une bataille perdue d'avance?", Les Tribunes de la santé 2004/1 (no 2)
Barbara Pick souligne les dérives des brevets qui sont devenus des outils de protection plus que d'innovations et affirment la nécessité d'un recours facilité la production de génériques. Elle prône donc un assouplissement des accords ADPICS et une facilitation d'accès aux licences obligatoires. Plus généralement elle est favorable à une diminution du monopole en matière de santé tant pour l'innovation médicale que pour l'accès aux soins. Cependant, elle ne fait aucunement mention des propositions générales de remise en cause du système de propriété intellectuelle dans ses interventions dans la controverse.
Publications :
La production de génériques et l'acc?des pauvres aux médicaments : le rapports des brevets et de l'OMC. Melchior, le site des sciences économiques et sociales(visible ici)
Barbara Pick, "La Politique européenne de brevets", Policy papers de la Fondation Robert Schuman, n?.
Ces deux chercheurs proposent de modifier le système de propriété intellectuelle en matière de santé afin que la recherche médicale réponde aux problèmes sanitaires majeurs.
Leur proposition est de mettre en place un système de récompense dont le montant serait défini avant la diffusion de l'innovation.
La première proposition est un système de cash out qui vise à ce que l'organe régulateur du système achète à la firme son brevet au montant équivalent aux bénéfices qu'auraient engendrés le brevet. Il produit puis vend les médicaments au prix comptant. Ce système est difficile à mettre en place d'un point de vue pratique, ne serait que pour estimer les bénéfices que pourraient engendrés un brevet.
La seconde proposition axe l'incitation ?a recherche sur les besoins réels en économie puisque le montant de la récompense serait fonction du poids économique de la maladie.
Leurs propositions manquent de soutiens et parraissent peu applicables.
Publications :
BARTON, J.H. et EMANUEL, E.J. (2005). "The patents-based pharmaceutical development process: Rationale, problems, and potential reforms", The Journal of the American Medical Association294 : 2075-2082.
Il s'agit d'un économiste du Department of Economics de Sciences Po Paris.
Il se prononce en faveur d'une limitation des effets monopolistiques induits par le système des brevets, et d'une refonte générale du système de propriété intellectuelle. Il propose un système de fenêtre d'ouverture, dit runner-up patent pour limiter les effets nocifs du monopole.
Emeric Henry soutient aussi les propositions qui visent à renforcer le rôle de la récompense comme le système de garantie de marché.
Publications:
"Runner-up patents: is monopoly inevitable?", Scandinavian Journal of Economics, 2010, 112(2), p 417?40. (visible ici)
Economiste auprès de la fondation Bill and Melinda Gates. Hannah Kettler tente de trouver des moyens de favoriser l'innovation dans la recherche médicale des maladies délaissées par les firmes pharmaceutiques.
Elle est à l'origine de la proposition de transférabilité des droits de propriété intellectuelle.
Publications:
"Narrowing the gap between provision and need for medicines in developing countries", London, Office of Health Economics.
Ces économistes sont à l'origine de la théorie du droit de traitement prioritaire. Le but de cette proposition est de récompenser les firmes qui développent des solutions sanitaires pour des maladies négligées en leur octroyant un droit de traitement prioritaire dans leurs futurs dépôts de brevets.
Publications:
RIDLEY, D.B., GRABOWSKI, H.G., et M&ŒLIG;, J.L. (2006), "Developing drugs for developing countries",Health Affairs25 : 313-324. (visible ici)
Ces deux économistes affirment que le système des brevets entraînent un sous effort de recherche, une sous production des médicaments à des prix plus élevé (principe même du monopole). Un système fondé sur la récompense apparait selon eux comme une solution meilleure du point de vue du gain total.
Ils proposent de changer de modèle de propriété intellectuelle en matière de santé, en définissant une récompense ex ante, en fonction des années de vies perdues par les membres de la société à cause de ladite maladie (récompense fondé sur le burden principle sur la base des "DALY"). L'idéal serait, selon eux, de définir une récompense ex post qui garantirait l'innovation comme le proposent Barton et Emanuel.
Cependant il ne détaillent aucun moment un moyen concret pour financer les récompenses visant les maladies des pays pauvres ou orphelines.
Publications:
"Comment favoriser l'innovation dans le secteur pharmaceutique : brevets et/ou récompenses ?" Reflets et perspectives de la vie économique 2006/4 (Tome XLV) 94 pages
Belleflamme: "How efficient is the patent system? A general appraisal and an application to the pharmaceutical sector." In A. Gosseries, A. Marciano and A. Strowel (eds.) Intellectual Property and Theories of Justice (2008).