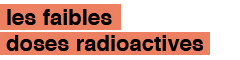CIPR
Commission Internationale de Protection Radiologique. Fondée en 1928 dans le cadre du Congrès international de radiologie, c’est une organisation internationale indépendante, soutenue par de nombreuses associations et gouvernements, visant à la protection contre les rayonnements ionisants. Ses recommandations concernent la mesure de l'exposition aux radiations et les mesures de sécurité à prendre sur les installations sensibles. Elles ne font pas force de loi mais sont reprises et adaptées par les législations nationales.
MELODI
Multidisciplinary European Low Dose Initiative. Plateforme européenne dédiée à la recherche sur les faibles doses afin de définir
HLEG
High Level Experting Group on European Low Dose Risk Research. Regroupement de six groupes d’experts impliqués dans la recherche sur les faibles doses, dont l’objectif est de déterminer les thèmes de recherche futures.
DoRéMi
Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration. Réseau d’excellence en vue de préparer la plateforme MELODI.
OPECST
Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques. Organe scientifique du Parlement, créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l'OPECST a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. A cette fin il recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études en procédant à des évaluations régulières.
ASN
Autorité de Sûreté Nucléaire. L'ASN assure, au nom de l'État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire.
mises en débat
A l’heure actuelle, les chercheurs ne sont donc pas capables de trancher sur le meilleur modèle dose-effet. Au fil des entretiens, une nécessité s’est peu à peu imposée d’elle-même : celle d’apporter d’avantage de contradiction dans le débat.
D’une part, beaucoup considèrent qu’il est urgent qu’une institution scientifiquement légitime s’érige en contre-pouvoir de la CIPR. A ce titre, les espoirs placés dans la plateforme MELODI, préparée par le programme européen HLEG auquel a succédé le programme DoRéMi, sont immenses.
D’autre part, au niveau plus local, il conviendrait certainement de développer la contre-expertise qui, malgré les efforts, demeure encore occasionnelle. De même, les associations de porte-parole des victimes ne sont pas assez présentes dans l’espace de la controverse. La CRIIRAD est presque la seule association qui parvienne à se faire une place dans le débat public et sa prise de position, que certains jugent trop souvent polémique, empêche à son activité de contre-expertise indépendante d’être reconnue comme complètement légitime (pour un exemple voir la vidéo).
Enfin, peut être faudrait-il encourager la coopération et le débat entre les différentes équipes de recherche, et créer des arènes de discussions constructives. C’est ainsi que l’OPECST organise chaque année un débat avec l’ASN pour qu’elle rende compte des avancées des recherches, des projets en cours etc. (voir la vidéo). L’idéal serait de faire de l’OPECST le lieu d’affrontement des acteurs.
La controverse des faibles doses radioactives a donc un avenir : celui de transformer ce danger public en problème public pour aboutir à une mise en débat constructive.