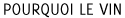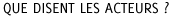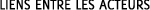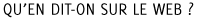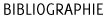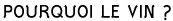
Ecoutez l’introduction à la controverse !
A l’heure où le repas gastronomique français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité répertorié par l’UNESCO, nous souhaitons nous pencher sur la tradition bien ancrée qui consiste à accompagner le repas d’un verre de vin. Geste de gourmandise ? Le vin a depuis toujours été considéré comme un alcool à part : une science lui est même dédiée, l’œnologie. La France, en particulier, a une longue tradition culturelle de consommation de vin : en 2008, un habitant français de plus de 14 ans consommait en moyenne 58,2 litre de vin par an. La France a également une longue tradition de production de vin puisque le secteur viticole se place au deuxième rang des productions nationales. Mais la valorisation sociale de la consommation de vin fait parfois oublier que le vin reste un alcool, et que ce dernier reste la seconde cause de mortalité évitable après la tabac (cirrhoses, accidents de la route, etc).
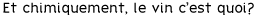
Le vin rouge est issu de la fermentation du jus de raisin par des bactéries et des levures (saccharomyces). Il peut être considéré comme un alcool car cette fermentation transforme les sucres du raisin (glucose et fructose) en éthanol. Cependant, les pépins et peaux de raisins donnent au vin une composition particulière : on trouve plus de onze polyphénols différents dans un verre de vin rouge, qui contient par ailleurs dix fois plus de polyphénols qu’un verre de vin blanc ou rosé.
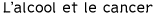
À forte consommation, l’effet cancérigène de l’alcool ne fait plus débat. Plusieurs mécanismes expliquent cet effet délétère. Tout d’abord, l’éthanol est transformé dans l’organisme en acétaldéhyde, une molécule considérée comme cancérogène et susceptible d’induire des lésions de l’ADN pouvant être à l’origine d’un cancer. De plus, l’éthanol favoriserait indirectement l’apparition de cancers en perméabilisant les muqueuses au niveau de la bouche, du pharynx, de l’œsophage, ce qui favoriserait la pénétration de substances cancérogènes comme le tabac.
Il est à noter que les hommes restent inégaux devant l’alcool : les effets de l’éthanol varient en fonction de la corpulence, du sexe, du patrimoine génétique, etc. Par exemple, les effets délétères de l’éthanol apparaissent pour une exposition plus faible chez les femmes que chez les hommes.
Le site web suivant est un exercice réalisé par des élevées dans le cadre du cours de Cartographie des controverses. Sciences Po, l équipe du cours déclinent toutes responsabilités pour les erreurs et les imprécisions qui peuvent exister dans ces sites. Le site a été réalisé et publié sur le web pour des raisons didactiques et de recherche. Pour rapporter des erreurs, n hésitez pas à écrire au responsable du cours (tommaso.venturini@sciences-po.org) The following website is an exercise realised by the students of the Cartography of Controversies course. Sciences Po and the course s team decline all responsibilities for the errors and inaccuracies that this site may contain. The site was developed and published on the Web for didactical and research reasons. To report any error, please write to the responsible of the course (tommaso.venturini@sciences-po.org)