







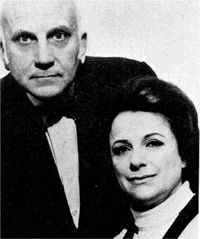
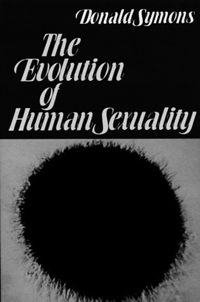
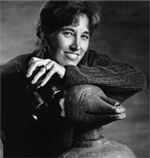


Notre controverse ne concernant pas une innovation technologique ou la découverte d’un phénomène, son sujet, l’orgasme féminin distingué du masculin, est présent dans la réflexion humaine depuis suffisamment longtemps pour qu’on puisse parler de « nuit des temps ». Pour preuve, Ovide se penche déjà sur les caractéristiques de la jouissance féminine dans ses Métamorphoses, au 1er siècle de notre ère. On peut repérer le début véritable de la controverse autour de ce sujet en 1920, lorsque Sigmund Freud se place à contre-courant de l’opinion commune, qui voulait que l’orgasme féminin favorise l’ovulation et donc la fertilité. La position de Freud révèle la possibilité d’un lien entre esprit/psychologie et orgasme, ce qui va au-delà de la simple fonction reproductrice et indique déjà la relation que l’orgasme peut avoir avec le cadre social, et notamment familial (l’orgasme clitoridien étant expliqué par un traumatisme infantile) Un deuxième pallier est passé après la seconde guerre mondiale, avec le début d’études biologiques d’envergure sur la sexualité humaine en général, et par conséquent sur l’orgasme féminin. Parmi les chercheurs de cette, période, on retrouve des fondateurs de la pensée scientifique en sexologie : Ernst Gräfenberg, Alfred Kinsey, William Masters & Virginia Johnson. À la fin des années 60, le monde occidental connait ce qui est généralement reconnu comme une révolution des mœurs, qui aboutit sur l’idée d’une sexualité libre et dégagée de la plupart des poids moraux qui semblaient l’affecter auparavant. Cette idée se répandant à travers les couches de la société, les individus développent un intérêt grandissant pour les sujets qui touchent à la sexualité et ceux qui en découlent : la demande pour des guides, des explications, pour la diffusion des théories scientifiques et non-scientifiques qui les sous-tendent explose. En conséquence, les différentes questions qui gravitent autour de l’orgasme féminin sont évoquées et intégrées par le public. Un exemple notable est la propagation de la théorie du point G à partir de 1981 à pratiquement l’ensemble du monde occidental. Vers la fin des années 70 environ, des études d’un autre type commence à voir le jour, de la part de scientifiques non-biologistes (anthropologues, chercheurs en psychologie évolutionnaire) qui s’intéressent à l’orgasme marginalement ou bien finissent par en faire leur sujet central ; parmi eux, on trouve notamment Donald Symons, Sarah Hrdy (pas de fautes de le nom !) et David Barash. Ceux-ci apportent une nouvelle dimension au problème de l’orgasme féminin et posent les premiers la question de la fonction évolutive de l’orgasme féminin et en font un débat. Il apparait que cette fonction n’est pas évidente, et de nombreuses théories voient le jour jusqu’à aujourd’hui. À l’extrémité de cette dernière vague de la controverse, Elizabeth A. Lloyd publie en 2005 The Case of The Female Orgasm, qui se penche sur les vingt principales théories concernant la fonction d’adaptation de l’orgasme féminin. Cet ouvrage, très incisif, met le feu aux poudres dans la communauté scientifique et transforme ce qui n’était qu’un débat en controverse.