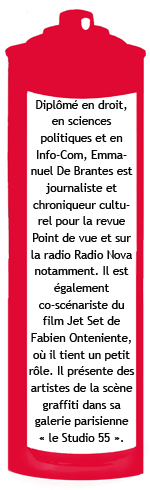|
|
|||
|
Retourner à la page Galeristes
Combien d’artistes exposez-vous par an ? EDB : Combien d’artistes est-ce qu’on expose par an ? Alors ça c’est une bonne question, j’ai pas du tout de notion. Ben, on a un noyau dur d’artistes qu’on expose avec lesquels on travaille depuis 5-6 ans régulièrement sur des expositions, sur des projets d’installations urbaines, avec des marques qui nous demandent des artistes dans telle ou telle catégorie. On a une quinzaine d’artistes qui fonctionnent dans ce sens-là très régulièrement tout au long de l’année, et puis en élargissant le nombre d’artistes qui viennent ici exposer sur des thématiques ou participer à des événements pour lesquels on demande des collaborations plus élargies, on doit tourner autour d’une cinquantaine. Comment les choisissez-vous ? Les connaissez d’abord ? EDB : Bien sûr, il y en a beaucoup qu’on connaît, il y en a qu’on découvre à travers les artistes qu’on connaît. Par exemple, là au mois de mars il y a une exposition à l’espace Louis Vuitton sur les Champs Elysées qui est consacrée aux écritures silencieuses, et dans cette exposition-là il y a un des artistes avec lequel on travaille depuis toujours qui est exposé. C’est nous qui sommes allés le proposer pour cette exposition-là et typiquement pour ce genre d’exposition-là, ils nous ont demandé que son rôle soit aussi bien un rôle d’artiste dans son œuvre, qu’un rôle de commissaire d’exposition où il invite d’autres artistes à venir participer à son œuvre « work in progress » tout au long de son exposition qui dure de fin mars à août. A travers ce projet spécifique-là, on avait besoin de 4 artistes supplémentaires à recruter et il y en avait deux enfin un dont je n’avais jamais entendu parler. Il s’appelle José Parla, c’est un Américain, il est formidable. Voilà, c’est aussi comme ça que ça fonctionne, un artiste vous parle d’un ami à lui, quelqu’un qu’il a vu en Israël, qu’il faut absolument repérer, c’est le jeune Banksy. Donc on se met à l’affût, on branche quelqu’un pour la recherche et c’est aussi comme ça qu’on se glisse sur le créneau en étant les plus rapides parce que c’est ça qui est important, être rapide à la détente. Définissez-vous cette discipline comme illégale ? EDB : C’est une discipline qui est illégale, c’est pas que je pense ça, c’est la loi qui m’oblige à penser ça. La loi continue d’être extrêmement contraignante en France, à tel point que vous vous écrivez votre nom sur un mur et vous êtes pris en flagrant délit, vous pouvez prendre jusqu’à 5 ans de prison pour cette bêtise-là. Comme dit Chris Marker, un cinéaste de renom que vous devriez connaître si vous ne le connaissez pas, qui a fait un court-métrage sur un artiste qui s’appelle Monsieur Chat qui fait des gros chats jaunes, il a fait un moyen-métrage sur cet artiste, et il a poussé à la comparer à l’effacement sur les murs de M. Chat au plasticage des statuts de Bimaya. Il a raison, c’est une forme d’obscurantisme qui est inacceptable. Pourquoi ? Parce qu’ils sont obsédés par l’idée que sinon la vitrine de la ville sera le reflet de la réalité de ses habitants, c’est-à-dire que tout n’est pas très propre dans le royaume du Danemark et pourtant le Danemark veut que ça ait l’air propre. Pensez-vous que toutes les personnes qui font du street art sont des artistes ou pas ? EDB : Potentiellement oui bien sûr, ce sont tous des artistes. En fait, le graffiti est une porte d’entrée pour des gens qui n’ont pas de formation artistique, qui ne sont pas sortis des écoles mais qui ont découvert que l’art pouvait se pratiquer dans la rue. Ils ont ouvert un livre un jour, ils ont vu des graffitis, ça leur a plu et immédiatement ils sont rentrés là-dedans comme une espèce de bouée de sauvetage, une bouffée d’air et ils ont tout appris. On a quelques artistes que l’on représente ici qui sont typiquement ce profil-là, qui n’ont absolument jamais fait autre chose que du travail urbain, du graffiti dans la rue en rencontrant d’autres artistes qui étaient un peu plus anciens qu’eux qui leur ont appris leur technique. C’est une transmission de savoir et c’est un atelier vivant et il y en a beaucoup qui sont dans ce profil-là. Nous avions rencontré aussi Miss Tic qui avait été arrêtée en 2000 et elle disait que pour elle, quelqu’un qui transgressait la loi n’était pas un artiste. EDB : C’est l’avis de Miss Tic, elle est formidable. Je me souviens des premiers graphes que j’ai vu à Paris, les tous premiers que j’ai vu c’était à New York et c’était Kieth Harring il y a 25 ans. Après quand je suis arrivé en France, j’ai découvert Miss Tic dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés avec ses pochoirs, ses slogans pleins de poésie, j’avais l’impression que c’était fait par Rimbaud. C’était une dame en fait que j’ai rencontrée par la suite qui avait bien roulé sa bosse. Peut-être qu’elle dit ça parce qu’aujourd’hui elle est très installée, les ministères lui commandent du travail, il y a des sociétés de location de voitures qui lui demandent un sponsoring, elle roule sur sa réputation. Moi j’ai pas d’avis, je vous dis simplement qu’il y a des artistes qui travaillent dans la rue et ce qu’ils font est considéré par la société comme illégal donc, on est dans la répression, dans la non-reconnaissance d’un travail artistique et dans le jugement d’une œuvre d’art, ce que l’on ne fait pas dans une galerie. Dans une galerie tout est permis, dans la rue il y a des bornes. C’est pas l’artiste qui est illégal, c’est la loi qui dit que ce que l’artiste fait dans la rue est illégal. C’est la propriété publique… EDB : Et alors ? Il faudrait changer la loi. Pourquoi s’empêcher d’avoir dans les rues, des choses un peu plus réjouissantes que de la signalétique. Pourquoi à la place de la publicité, réserver une partie des panneaux publicitaires des villes pour de l’art et non pas de la publicité. Pourquoi est-ce qu’on continuerait à vivre dans un système que tout le monde commence à rejeter ? Ca ne sert à rien de se mettre des ornières en se disant « faut continuer tels que nous sommes » et on marche vers la mort comme des imbéciles. On a vécu les limites de ce système-là, maintenant il faut qu’un art devenu global qui est le seul mouvement artistique dans l’histoire de l’art à toucher les 5 continents, et à être un mouvement actif et constamment plus actif grâce à Internet qui véhicule les faits à la vitesse grand V. Pourquoi maintenant que cet art est global, avec un impact au niveau du public, des musées, des collectionneurs, pourquoi est-ce que cet art-là continue d’être illégal dans certains pays ? C’est absurde, ça ne sert à rien, c’est scandaleux, c’est une atteinte à la liberté d’expression. D’ailleurs, les échelles de valeur dans la société dans laquelle nous vivons, il s’agit de savoir ce qui est le plus important. Est-ce que c’est le droit de propriété, la liberté d’expression ? Moi je dis que c’est la liberté d’expression parce qu’on meurt pour exprimer son opinion, alors que mourir pour une maison, à quoi ça sert ? Tu déménages. Vous dites que c’est un art global, et vous avez parlé d’artistes américains. Est-ce qu’il y a des artistes français ? Comment se porte le marché français ? EDB : Le marché du street art, c’est une expression un peu curieuse. Disons que oui le monde du street art ou du graffiti, ou du post-graffiti, se nourrit de ce qui s’est fait en Amérique parce qu’en Amérique tout a été inventé dans ce domaine-là. Les premiers graffeurs français se sont nourris de ce qu’ils ont vu aux EU, ils se sont inspirés de cette recherche graphique, de cette composition de caractère, format, grosses bulles, les noms qu’on mettait sur les métros, etc.… Ca c’était des images qui leur parvenaient dans des albums, dans les rares revues qui parlaient de ça au début des années 80. Et puis des Américains sont venus s’installer en France et ils ont continué à faire ce qu’ils faisaient aux Etats-Unis en France. Donc c’est cette prolifération qui s’est faite comme ça. Après, la 1ère, 2ème maintenant 3ème génération de graffeurs. Avec la 1ère qui était purement « white style » à la recherche de sa signature, sa manière d’écrire son nom, plus ou moins variée avec des créations de polices de caractère qu’ensuite l’industrie pille. Encore une fois je vous dis que le système passe son temps à piller les artistes quand ça les intéresse et ensuite quand ça les intéresse plus et qu’on touche à une micro-parcelle de son confort, alors ça y est il faire appel aux flics, à la justice, pourquoi pas remettre la guillotine, c’est n’importe quoi. D’autant plus que si on repense un peu à la période de la Renaissance, qui est un peu mon dada, que je répète constamment, qui étaient les gens les plus consultés par les chefs d’Etats et les gouvernements ? C’était les artistes parce qu’on savait que les artistes apportaient un regard différent sur la société et donc apportaient des solutions que tous les fonctionnaires machin ne pouvaient imaginer. Evidemment en France, avec le moule de l’ENA qui fabrique des gens de même format, on se dit pourquoi diable ils se décoincent pas un peu et ils font appel à des gens qui pensent un peu différemment d’eux ? Le street art est donc très accessible. Est-ce-que c’est tendance ? Qui achète ? EDB : Alors c’est deux questions très différentes. C’est la première fois qu’on me pose la question : est-ce-que c’est tendance ? Oui, j’en sais rien. Franchement oui, tendance ça a plutôt un côté mode, donc on se dit « est-ce-que le pantalon court c’est tendance ? – Ouais. » C’est dans l’air du temps c’est vrai, mais c’est-à-dire ça prend toujours du temps pour que la reconnaissance d’un milieu soit authentifiée et vraiment acceptée. C’est vrai qu’on dit toujours que la France a 20 ans de retard sur les Etats-Unis et si on dit ça, et qu’on compare, au milieu des années 80 le graffiti commençait à être super polémique aux Etats-Unis parce que ça proliférait partout mais avec la répression est arrivée forcément la reconnaissance parce qu’on disait « c’est un problème ». Donc ça existe, donc reconnaissance, reconnaissance par la négative mais reconnaissance quand même. 20 ans plus tard, c’est exactement ce qui se passe en France aujourd’hui reconnaissance par la négative d’abord et maintenant reconnaissance par la positive un tout petit peu. Par exemple, Beaux-arts magazine qui fait sa couverture sur le graffiti art, c’est des tendances générales si on peut dire des tendances qui font que le public s’intéresse, il y a une génération qui a grandi avec les graffiti et qui tout à coup voit qu’on fait appelle à cette discipline-là beaucoup plus dans différentes manifestations, des manifestations, des salons, des happenings. Il y a une manière plus active, plus réactive, plus physique d’exercer l’art, c’est plus une performance que les autres arts plastiques qui font moins appel à la performance ou alors c’est un tout petit peu comme Yoko Ono avec des choses comme « je me mets dans un carton et j’en sors avec de la musique hindoue », voilà « je découpe ma robe sur scène et je repars nue ». ça c’est des choses un peu conceptuelles mais tendance oui, je crois que oui il y a un rattrapage de ce que la réalité fait qu’il y a une génération entière, qui est la vôtre, qui a grandi avec le graffiti partout, qui n’est pas le cas de la génération de vos parents où le graffiti était encore une chose tellement nouvelle que « Oh, c’est dégoutant sur cet immeuble », sauf quand il y avait quelque chose de figuratif, de plaisant, ce que fait M. Chat par exemple ou André, où ça décoche un sourire alors là forcément bien parce que c’est sympathique. Mais ça n’est pas toujours sympathique l’art, il y a de l’art qui est un poil à gratter, qui perturbe, qui pousse à la réflexion. Cet art-là commence à être un peu plus reconnu et le graffiti en fait partie. Pour ce qui est des collectionneurs et des gens qui s’intéressent à cet art-là, il y a de tout. Il y a des collectionneurs, des grands collectionneurs qui collectionnent par ailleurs des artistes très établis des années 70, 80 voire des artistes plutôt anciens et qui maintenant commencent à diversifier leurs collections avec des pièces d’exception venant du graffiti. Il y en a d’autres qui ont des collections entières de graffiti, extrêmement complètes et qui collectionnent depuis 20 ans des petites pièces puis des grosses pièces, et qui ont maintenant 300, 400, 600 pièces dans leurs collections. C’est assez impressionnant, ce sont des vrais maniaques, des vrais collectionneurs. Et puis, il y a tout une population qui n’a pas forcément autant de moyens pour acheter de grosses pièces conséquentes, parce qu’il est vrai qu’il y a certains prix qui s’affolent, il y a des toiles de JonOne qui atteignent 35 000 euros, mais aux EU, certains artistes confirmés du street art comme JonOne, des Américains, ils atteignent les 100 000 dollars, des 200 000 dollars parfois, donc c’est des sommes un tout petit peu disproportionnées. En France, malgré cette tendance à la croissance des prix, on passe quand même à travers une dépression qui va remettre quelques pendules à l’heure, il y a aussi tout une jeune génération à la recherche de choses plus accessibles, pas chères, donc des artistes sur lesquels ils peuvent faire un pari. On en a un ici dans la galerie qui s’appelle Gobelin qui est un tout jeune artiste qui a fait une pièce pour nous dans le cadre de cette exposition-ci. Il n’a pas exposé avant dans une autre galerie, c’est un travail nouveau, c’est un pari sur l’avenir. Donc il faut savoir reconnaître ça et aussi proposer ce travail-là pas trop cher pour de nouveaux acquéreurs qui auraient envie de. Donc il y a de grands collectionneurs, les amateurs éclairés à qui il faut proposer quelque chose qui corresponde à un investissement artistique et puis les jeunes collectionneurs à qui il faut proposer des pièces qui sont abordables, ça commence à 100 euros. Comment estimer la valeur d’une œuvre de street art ? EDB : Qu’est-ce-qui fait la valeur d’une œuvre ? La signature, déjà, il y a des artistes qui sont présents dans des collections internationales, des musées internationaux, à Philadelphie… Il y a des artistes qui sont déjà côtés avec les ventes publiques, les ventes aux enchères donc ça leur donne une côte officielle. Voilà, on a des éléments tangibles qui permettent de savoir pourquoi un tel est cher, parce qu’il est déjà dans les musées, c’est donc forcément un investissement sûr, et puis il y a d’autres qui sont moins connus qui ont moins exposé qui ont moins travaillé, qui sont tous jeunes sur le marché et il faut les appuyer aussi. C’est ce qu’on fait ici, on travaille avec des artistes qui n’ont jamais exposé ou très peu. Vous dites qu’il y a des artistes de street art qui sont exposés dans des musées aux Etats-Unis, est-ce qu’en France ils sont exposés dans des musées ? EDB : Il y en a quelques uns, des FRAC de fonds régionaux qui ont acheté des pièces de graffiti. Enfin bon, c’est encore très conservateur. Je me souviens des déclarations de plusieurs ministres de la culture, tout au long des années qui viennent de s’écouler et qui ont toujours dit : « Oui, il faut investir dans l’art urbain, bla bla bla. » C’est jamais suivi d’effets, c’est jamais suivi d’une lettre aux FRAC disant : « Désormais achetez des œuvres d’art urbain. » Bon on fait du graffiti sous les verrières du Grand Palais, on appelle ça Rue au Grand Palais et puis on fait venir 20 000 personnes pendant 4 jours sous les verrières du Grand Palais et c’est un grand succès. On promet qu’on va organiser des événements et faire de ça un rendez-vous annuel, bla bla bla, c’est paroles de politicien, il n’y a jamais rien derrière. On flatte l’opinion, on montre qu’on est capables d’être présents et on ne fait aucune réflexion sur la durée et on ne fait aucun effort pour reconnaître la valeur de ce travail artistique. Le street art est un art sous-représenté ? EDB : Totalement sous-représenté, c’est d’ailleurs pour ça que nous avons monté cette galerie, pour participer au mouvement de reconnaissance générale. Donc ça reste quand même cantonné aux galeries pour le moment ? EDB : Ben en France beaucoup oui, les institutions ne sont pas très friandes. D’ailleurs, elles disent de temps en temps : « Donnez-moi 10 graffeurs, je vous donne un artiste. » C’est une forme de mépris extraordinaire. Donc voilà, dans un terrain comme celui-là c’est très difficile d’imposer ses choix, il faut proposer constamment de la qualité, constamment élever le niveau d’intervention pour qu’à chaque fois on se dise : « c’est impressionnant », et chaque fois prouver grâce à l’artiste qui perce que justement « vous vous étiez trompés ». Mais êtes-vous optimiste ? EDB : Mais moi je suis d’un incorrigible optimisme. Chaque année qui passe me prouve que j’avais raison il y a 10 ans. Peut-on traduire street art par art urbain ou par graffiti ? EDB : Il faut le traduire par art urbain. Parce qu’un graffiti est un dessin, c’est ce que disait Picasso : « L’œuvre d’art, c’est un graffiti, un trait sur un mur. » Donc il avait raison, c’est l’expression artistique pure, réduite à sa plus simple expression, un trait voilà ça c’est un graffiti. Après il y a l’art urbain qui peut être aussi bien des contours, des ombres portées, qui est une manière de peinture qui n’est pas du graffiti car il n’y a pas de calligraphie. Le graffiti c’est une écriture, on met son nom sur un mur ou sur un métro aérien pour que tout le monde le voit : « Ah tiens tu as vu passer un tel. T ‘as vu je suis passé… ? ». C’est la reconnaissance et donc la quête de l’excellence mais ça passe par une expression libre et malheureusement elle ne l’est pas toujours. J’ai une dernière question technique, si on veut acheter du street art qui a été fait sur un mur dans la rue, comment fait-on ? EDB : Ah ben bonne chance ! Non ben ça n’existe pas, il y a des gens qui décollent des affiches qu’ils ont vues dans la rue parce qu’ils trouvent ça beau et ce sont des collectionneurs endormeurs, donc ils arrivent avec leurs brosses et de l’eau un peu chaude, ils passent ça sur une affiche murale, ils décollent ça délicatement et hop ils repartent avec. Ils se sont confisqués un truc qu’ils estimaient à tout le monde, c’est pas très bien. Maintenant sur un mur, je vais vous dire il y a une bonne réponse à votre question, c’est au 33 Faubourg Saint-Antoine, il y a un immeuble, dans la cours, à droite il y a un espace avec quelques marches, et quand on regarde par la fenêtre il y a une colonne en béton et sur cette colonne il y a un dessin de Keith Harring qui l’a fait au début des années 80 et qu’on a jamais pu enlever parce que c’est sur du béton, c’est sur une colonne de soutènement, ça mène à quoi, ça le détruirait ? Donc ils ont mis un verre et un cadre sur la colonne et du coup on a une œuvre d’art qui fait partie du paysage. Voilà c’est la seule manière il faut racheter les murs. |
|||
|
Copyright © 2009 Street Art - All Rights Reserved |
|||